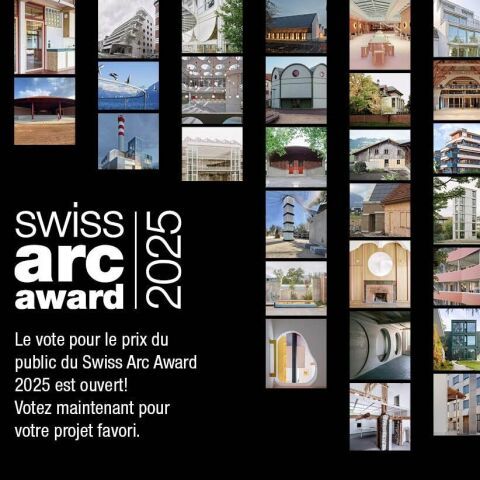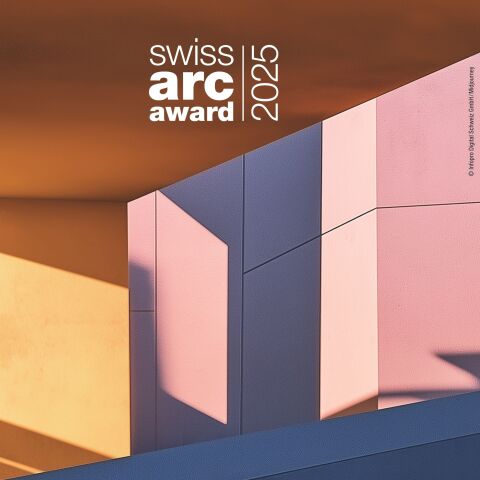Lifetime Achievement Award 2024 – Gion A. Caminada en discussion avec Jørg Himmelreich

Gion A. Caminada | Photo: Alexander Dimitriou
Cher Gion, la rédaction de Swiss Arc te félicite pour le Lifetime Achievement Award, un prix qui récompense l’œuvre d’une vie qui est décerné pour la première fois dans le cadre du Swiss Arc Award 2024. Cet entretien est l’occasion de porter un regard rétrospectif sur ton travail d’architecte, mais aussi, et cela nous intéresse encore plus, d’évoquer tes travaux actuels et les questions et thèmes qui te préoccupent.
Penchons-nous d’abord sur tes années d’apprentissage. Après une formation de menuisier, tu fréquentes l’école des arts et métiers de Zurich et enchaînes avec un diplôme d’architecture obtenu à l’EPF de Zurich. Quelle est l’influence actuelle de ces étapes pour ton activité d’architecte?
Ma formation de menuisier a été une très bonne base pour mon travail – un réel leitmotiv. Et le temps passé à l’EPFZ, pendant les études et au cours des 25 ans d’enseignement, m’a fortement marqué.
Quels thèmes as-tu explorés en étant professeur?
À l’EPFZ, nous nous sommes intéressés à Vrin et à Vals pendant tout un semestre. Et 25 ans après, nous sommes retournés à Vrin pour boucler la boucle. La situation a beaucoup évolué ces dernières années – là-bas, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Et cette réalité modifiée a donné naissance à des projets très différents de ceux d’alors. Alors qu’avant, l’enjeu majeur consistait à trouver de nouvelles perspectives pour le lieu, les récentes discussions sont inspirées par le caractère concret du lieu.
Qu’entends-tu par «concret»? Une connaissance fondée des matériaux et de la construction? Une analyse complète du lieu, et à laquelle fait écho une architecture sensible?
Le concret, c’est peut-être tout simplement la relation avec l’environnement. Dans ma jeunesse, nous ne faisions pas la différence entre nature et culture. L’environnement n’était ni idyllique ni mauvais – il était comme il était. Ce n’est que plus tard que j’ai été confronté à d’autres questions: qu’est-ce que le paysage, la culture, la nature? Pour la plupart des gens, ce sont des sphères séparées. Comme beaucoup d’autres, je plaide aujourd’hui pour une pensée plus symbiotique de la nature et de la culture. La grande réconciliation que certains appellent de leurs vœux ne fonctionne toutefois pas. Le débat autour du loup est un bon exemple. Lui n’est pas intéressé par une relation avec nous. Et ce n’est pas que perceptible dans les régions de montagne: dans certains cas, la culture est un complément ou un prolongement de la nature, dans d’autres, elle s’y oppose et la maîtrise. Cela signifie donc concrètement que nous ne vivons pas dans la nature et la culture, mais dans des situations concrètes et à des endroits précis, dans lesquels nous devons à chaque fois trouver des repères. Nous devons apprendre la résilience pour l’avenir.
Tu es né ici et c’est aussi à Vrin que tu as fait ton apprentissage de menuisier. Les études t’ont emmené dans d’autres endroits, à Zurich et ailleurs. Tu as ensuite décidé d’ouvrir ton atelier d’architecture dans le Val Lumnezia. N’as-tu jamais songé à t’installer et travailler à Zurich ou dans une autre ville?
Mon cœur, lui, est toujours resté ici. Mais j’ai aussi une accointance cosmopolite. J’entends par là une vision possible du monde et un rapport à celui-ci, mais avec un accent entièrement concentré sur ce qui est spécifique à l’espace à aménager. C’est entre autres de là qu’est née pour moi une forme d’enseignement et de pratique: le cosmopolitisme comme mode de pensée, l’apprentissage de la différence comme méthode de travail et l’attention portée au local dans la mise en œuvre. Ces trois thèmes ou notions n’ont pas cessé de se consolider au cours de mon parcours de vie, et sont très importants dans mon travail.
Vrin est à mes yeux comme un laboratoire dans lequel j’ai pu, des années durant, accumuler des expériences. Mais il faut faire attention à la manière dont on travaille avec ces expériences; il faut les transcender. Il est d’un côté important d’être constamment proche des choses. Mais de l’autre côté, il est aussi indispensable de s’en éloigner et d’y réfléchir à distance – un peu comme dans l’allégorie de la caverne de Platon. On atteint l’idée en sortant de la caverne. Mais il faut y retourner pour éclairer l’idée depuis la caverne. Le non-savoir est une composante importante. Ne pas savoir signifie pour moi explorer, aller plus loin, vouloir savoir ce que cela pourrait être. Pour le dire de manière provocatrice, la situation devient difficile lorsqu’à un certain âge, l’expérience remplace l’ignorance. C’est ce qui m’a guidé au cours des 35 dernières années. Je suis reconnaissant à Vrin d’avoir été ce lieu d’éducation. Certaines choses s’apprennent, d’autres sont innées. «On devient ce que l’on est par et contre les autres», disait André Comte-Sponville.
Quelle architecture résulte du fait de ne pas considérer culture et nature comme deux sphères séparées?
Je plaide pour une approche plus directe, concrète en somme, sans clivage ni idéalisation. Dans cette complexité se trouve quelque chose qui donne du sens au quotidien de l’homme, et du sens à l’architecture. Si nous considérons ce que l’on appelle les ressources comme quelque chose de vivant, nous y verrons alors plus qu’une simple possibilité d’en tirer un capital. La matière est plus que quelque chose de muet et que l’on peut utiliser. La considérer comme un vis-à-vis, c’est lui accorder une certaine valeur. Dans le meilleur des cas, elle résonne, et fait quelque chose avec nous. Cette attitude touche à l’éthique, et si l’on parvient à créer un lien entre esthétique et éthique, la beauté change de sens pour devenir une valeur, un engagement et une responsabilité. Cette idée a beaucoup à voir avec mes souvenirs d’enfance mais aussi avec mes expériences plus tardives. Je suis convaincu qu’il faut une autre appréciation des choses, c’est seulement alors que nous pourrons contribuer à un monde meilleur. Cette attitude n’est ni un «retour à la nature» ni un plaidoyer ésotérique – c’est plus que cela.

Vue sur le village de Vrin | Photo: Ralph Feiner
On le comprend bien au travers de ton travail à Vrin. Il y est question d’architecture et de spatialité, mais aussi des dimensions sociales, politiques et économiques. Tu as réalisé quelque chose qui va au-delà de la concrétude du construit. Est-ce cela que tu évoques lorsque tu parles avec insistance de «créer des lieux» au moyen de l’architecture?
Contrairement à l’espace, le lieu est à l’échelle de l’homme. À mon sens, un lieu représente un ensemble de responsabilités. J’étais et suis toujours prêt à assumer une responsabilité pour Vrin par exemple, et c’est pour cela que ce lieu prend une dimension tout autre à mes yeux. C’est pourquoi je plaide pour que, contrairement à l’évolution actuelle, l’espace de compétence soit divisé en petites unités. Ce n’est qu’ainsi que nous serons capables d’agir. Le problème de l’époque actuelle est le suivant: nous construisons trop de choses concrètes et créons trop peu d’espace pour les événements et les faits. L’architecture ne peut et ne doit pas planifier l’événement. Mais l’architecture peut créer des structures pour que les événements puissent se dérouler, et pour répondre à certaines questions: dans quelle mesure limiter quelque chose et dans quelle mesure l’ouvrir? Un rapport équilibré entre distance et proximité est déterminant pour les événements. Prenons l’exemple de Valendas où nous avons construit une auberge tenue par un homme remarquable. Sa personne et les événements qui se déroulent à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment ajoutent au site une valeur supplémentaire. C’est notre devoir que de créer d’autres lieux.

Hôtel Maistra 160, Pontresina, 2023 | Photo: Ralph Feiner
Peux-tu expliquer cela plus en détail à l’aide d’un autre projet?
La chambre mortuaire, la stiva da morts à Vrin, reste le plus grand défi de ma carrière. Beaucoup de choses y sont mêlées. Les grandes questions de l’être humain comme la douleur et le soulagement. Qu’est-ce que la mort? Comment gère-t-on le deuil? Comment les gens se sentent-ils dans ces moments-là? Quel caractère spatial peut accompagner le deuil ou aider à le surmonter? J’y ai travaillé pendant sept ans, et cette expérience s’est ensuite révélée unique et déterminante pour des projets ultérieurs. C’est même devenu une maxime pour moi: si je fais quelque chose de bien, voire de juste, alors je suis capable de bien faire d’autres choses.
Mais chaque projet de construction et chaque situation ne sont-ils pas différents?
J’ai souvent dit à mes étudiant·e·s: occupez-vous spécifiquement d’une chose pendant toute votre vie – jusqu’à la fin. Que ce soit l’apiculture ou autre chose, cela n’a pas d’importance. Bien entendu, ce quelque chose doit aussi laisser place à d’autres choses. Expérimenter et sentir ce qui change au cours du processus, c’est incroyablement important. Si je fais quelque chose aujourd’hui et autre chose demain, je ressens certes des différences et de la diversité, mais ne sais pas ce qui change. Je ne peux le faire que si je reste concentré sur la même chose. Je pose toujours les mêmes questions ou des questions similaires, mais j’obtiens des réponses différentes. C’est par la répétition que l’on apprend le plus. C’est avec ce credo que j’ai développé ma méthode de conception architecturale.
Global et local, continuité et changement, directives et flexibilité, autant de pôles qui t’ont occupé en tant qu’architecte et théoricien pendant de nombreuses années. Si je lis bien, tu as tenté de faire tienne la dialectique qui en résulte pour enrichir tes projets.
Ce ne sont pas des contraires à mes yeux. Ils ont en fait toujours été associés. Prenons le cas de la continuité et du changement: pour contribuer au développement d’un lieu, j’essaie d’activer, de renforcer ou même d’amplifier les forces présentes. Cela donne sa propre force ancestrale à un ensemble, à un village ou à un quartier. Travailler dans la continuité ne signifie pas pour autant ne pas apprécier le contraste, ou ne pas aspirer au changement. À Vrin, la quête du bien-vivre depuis mon adolescence a également engendré une continuité architecturale. On construisait de nouvelles choses avec l’espoir d’un monde meilleur. Je continue de suivre cette attitude dans mon quotidien. Je suis par ailleurs confiant dans le fait que le monde peut devenir meilleur. Bien sûr, les souvenirs (idéalisés) y jouent un rôle important. Ceux-ci ne peuvent pas être supprimés et sont importants. Ils nous évitent de perdre des valeurs. Mais il ne faut pas non plus laisser ces souvenirs nous paralyser, et il est tout aussi important de prendre du recul, car cela permet de faire du neuf.
Ensuite, au sujet du global et du local: enfant, je pensais que Vrin était le monde et qu’il n’y avait rien de plus en dehors. Puis le grand changement est arrivé. Le monde est arrivé à Vrin et a changé son esprit. Il n’est plus possible de faire aujourd’hui ce que l’on pouvait faire ici il y a 30 ou 25 ans. Il y a désormais trop d’éléments étrangers et trop peu d’éléments propres – les éléments étrangers nous déterminent même dans les coins les plus reculés de la planète. Tournons-nous à l’avenir davantage vers ce qui nous est propre.
On sait que les régions de montagne connaissent deux évolutions contradictoires. Il y a les stations qui, poussées par le tourisme, ne cessent de croître, et il y a les vallées qui deviennent des périphéries. Ces deux mondes sont proches l’un de l’autre, mais présentent des dynamiques très différentes. Tu as consacré de nombreuses années à Vrin et donc principalement à la périphérie. Plus récemment, tu as toutefois réalisé de plus en plus de projets dans des régions en pleine croissance. Le Maistra, par exemple, est un hôtel érigé dans un lieu touristique. Peux-tu transposer les approches que tu as développées dans la périphérie pour construire en station? Ou bien dois-tu pour cela repenser l’architecture de fond en comble?
En architecture, il en va selon moi de deux choses: le concept et l’empirique – sans relation avec la situation et le lieu. Le concept est une construction intellectuelle, qui dans le meilleur des cas structure l’idée et lui donne une certaine consistance. L’empirique, c’est notre expérience, l’émotionnelle. Le défi est d’amener les deux phénomènes à résonner ensemble. En tant qu’architecte, je suis d’une part un scientifique, mais au moins autant pragmatique. Travailler dans et avec un lieu nécessite à mon sens ces deux formes de savoir, celui de l’expert et celui du pragmatique local – le paysan ou le prophète de la météo. Ces deux attitudes ne sont pas d’une utilité directe pour l’architecture telle que je la conçois, mais elles sont néanmoins indispensables dans le processus. En outre, je cherche pour chaque lieu ce qui me permettra de créer un sentiment d’appartenance. Ta question fait allusion aux conclusions du «Portrait urbain» du Studio Bâle de l’EPFZ, et à ses implications politiques. Les auteur·rice·s partaient du principe que dans les endroits isolés, seuls les complexes hôteliers avaient une chance de survie. La situation a changé au cours des dernières années, et on est à la recherche de lieux isolés. Le changement est tel que le couple diversité et différence constitue pour la périphérie un des plus grands potentiels. Parce qu’elles se complètent, nous devons mettre en relation ville et périphérie. Mais il est toutefois important de renforcer ce qui les différencie l’une de l’autre. C’est selon moi le plus grand acquis du portrait urbain.
Tu as décrit comment le développement architectural de Vrin a permis au village une imbrication toujours plus importante avec le monde. Est-ce là ce que tu entends par «mise en relation»? Considères-tu cela comme une stratégie applicable aux périphéries alpines en général? Tout à l’heure, tu semblais plutôt critique à ce sujet.
Sur le principe, oui. Mais il faut faire attention. L’imbrication ne doit pas mener à une généralisation, sans quoi le risque de voir se diluer la force qui réside dans la différence serait grand et aurait pour conséquence la perte de ce potentiel. Nous devrions nous demander comment développer un lieu et y faire quelque chose sans qu’il perde sa spécificité malgré le fait qu’il entre en relation avec le monde. Au début de notre aventure à Vrin, nous avons été radicaux en essayant de préserver l’authenticité des lieux – si l’on peut dire cela ainsi. Cela n’a été possible que dans une certaine mesure. Le monde vient naturellement et on ne peut pas l’arrêter. Ce qui était étranger est plus présent aujourd’hui qu’il y a 40 ou 50 ans. Mais je reste malgré tout confiant. Si l’on continue à développer la périphérie dans les Alpes, il est alors nécessaire de se demander comment gérer la question des résidences secondaires. En voulons-nous encore plus? Est-ce suffisant? Quelle serait l’alternative? Nous ne devrions pas nous contenter de discuter des possibilités offertes par une législation, mais dire ce que nous voulons. Ce n’est qu’alors que débutera la discussion au sujet de ce qui, par exemple, revient aux régions de montagne dans cette considération globale.
Tu t’es penché de manière intensive sur les questions de la protection des sites et considères le fait que les bâtiments se ressemblent et forment des groupes aux caractéristiques comparables. Tu rejettes la volonté de se démarquer par la conception du projet, c’est-à-dire d’attirer l’attention par la différence, du moins en ce qui concerne la forme extérieure. Je perçois toutefois une recherche de diversité et de complexité spatiale dans certains de tes espaces intérieurs. J’ai notamment en tête l’escalier sculptural avec ses espaces de détente intégrés du pensionnat de jeunes filles de Disentis. Peut-on dire de ton architecture qu’elle est marquée par une recherche d’intégration ou de cohérence à l’extérieur et d’individualité et de diversité spatiale à l’intérieur?
Si je considère par exemple un village bien ordonné – Vrin ou ailleurs – il ne s’agit jamais d’une unité. Le village a toujours été une somme d’ensembles. Or, un ensemble est clos en soi et donne l’impression d’être «fini». Ce ne qu’à cette condition que s’établit la relation avec l’ensemble suivant. J’attache beaucoup d’importance à respecter cela dans chacune de mes réalisations. Il s’agit pour chaque construction, qu’elle soit groupée ou isolée, de trouver un équilibre entre appartenance et autonomie. Chaque chose doit exprimer une certaine autonomie – une autonomie tirée de son contexte. Une personne qui ne dégage pas une certaine assurance ou une certaine confiance en soi éprouvera des difficultés au sein d’une communauté. Il en va de même d’une construction. Toute bonne maison se suffit à elle-même, mais elle fait aussi partie d’un ensemble plus vaste. Dans ce contexte, l’autonomie ne doit pas être égoïste ou prétentieuse, mais participer de l’ensemble plus vaste.

Internat de jeunes filles au couvent de Disentis, 2004 | Photo: Lucia Degonda
Lorsque je pense à tes constructions, je perçois différents moments d’autonomie. Mais le besoin de les intégrer semble clairement être au premier plan. Dans cette mesure, j’aimerais revenir sur le thème de la «valeur de la différence». Tu as en effet déclaré qu’il s’agissait d’une notion centrale dans ton enseignement.
La différence a été centrale pour moi dans l’enseignement et reste aujourd’hui un thème important dans le projet. Elle ne doit cependant pas être créée arbitrairement – ce qui équivaudrait à la copie – mais surgir des conditions et des caractéristiques spécifiques du lieu. Il est important de reconnaître la force et le sens d’un contexte spécifique. Une fois trouvée, il s’agit alors de la renforcer. J’ai appris quelque chose d’important: il faut un minimum de presque-semblable pour qu’une différence apporte sa plus-value. Y parvenir, c’est se rapprocher du phénomène de l’identité.
Il est donc moins question de différences significatives que de nuances précises?
Il s’agit de déceler ces différences et d’en imprégner l’ouvrage. L’ensemble de logements Burggarta à Valendas, par exemple, rend perceptibles les spécificités du lieu et les conditions locales qui sont reflétées à travers le leitmotiv de l’idée: «J’habite avec la maison et son environnement, et la maison habite avec moi». Cette interaction suggère un quasi-sujet et un quasi-objet au sens de Bruno Latour, ce que je trouve extrêmement intéressant. À Valendas, nous avons organisé les appartements en différentes zones climatiques. L’idée m’est venue de ma jeunesse. À la maison, en hiver, le seul espace chauffé était la pièce où tout le monde se réunissait autour du poêle chaud. Je ne voulais pas imposer la même chose aux habitant·e·s des immeubles de Valendas, mais souhaitais activer cette qualité appartenant à mes souvenirs pour une forme d’habitat contemporain. C’est pour moi une manière d’aller de l’avant vers plus de durabilité, car lorsqu’on parle d’efficacité, l’idée de suffisance n’est jamais loin. En parlant de durabilité, on pourrait dire que l’efficacité signifie une meilleure technique, tandis que la suffisance induit des personnes meilleures. Les deux se heurtent à des limites. Pour moi, la suffisance ne signifie pas renoncer à quelque chose, mais découvrir des qualités qui sont encore cachées et absentes, pour en faire des qualités tangibles de l’habitat.
S’agit-il aussi, dans le cas de Valendas, d’apprendre aux habitant·e·s à apprécier davantage l’énergie nécessaire au chauffage lorsqu’ils se déplacent entre les pièces froides et chaudes en hiver?
On a imaginé trois zones de températures différentes. Les cuisines et les salles de bain sont en béton. Contrairement aux autres pièces, elles accumulent beaucoup plus de chaleur par le biais de la massivité de leurs cloisons qui fonctionnent comme celles d’un poêle en stéatite. Avec la chaleur rayonnante, on a l’impression que l’on peut transporter la chaleur et qu’elle a un poids spécifique. En hiver, les cuisines sont les zones les plus chaudes de la maison, avec 22 à 25 degrés Celsius, alors qu’en été, elles sont les plus fraîches. Ensuite, il y a des pièces tempérées dont l’utilisation est diverse. Celles-ci sont utilisées très différemment en été et en hiver, et sont chauffées par le rayonnement solaire direct. Elles peuvent presque atteindre une température de 20 degrés par une belle journée d’hiver, grâce à l’apport calorique passif. Il y a aussi la zone froide, dans laquelle on atteint parfois moins 10 degrés en hiver. Les diffé-rentes zones de température enrichissent à mon avis l’habitat. Avec Burggarta, ce qui était autrefois une contrainte est devenu une forme d’engagement.
Tu as précédemment évoqué ton souhait de dépasser le clivage qui s’opère dans nos têtes entre nature et paysage culturel. Un logement avec une pareille mixité climatique doit aussi inciter à passer plus de temps à l’extérieur?
Bien au contraire! Avec ces logements, pas besoin de sortir du tout. Si je veux de la chaleur, je me déplace de la chambre à coucher vers le séjour et la cuisine. Mais je peux aussi faire un détour par d’autres pièces. Le grand objectif de l’architecture devrait être de construire des espaces qui soient tellement appréciés qu’on ne veut plus les quitter. Des logements de qualité et des événements contextuels porteurs de sens représentent un grand enrichissement pour la vie. C’est ce que l’on a tenté de faire à Valendas.
Regardons plus précisément la matérialité et la construction. Tu t’intéresses depuis de nombreuses années aux matériaux de construction locaux et aux techniques traditionnelles, en particulier à la construction en bois. En Suisse, le bois a longtemps été principalement utilisé pour les bâtiments agricoles et les infrastructures. Dans le cadre de l’évolution du débat sur la durabilité, qui met actuellement l’accent sur les émissions de CO2 liées à la production et au transport des matériaux, les constructions en bois se multiplient dans tout le pays. Que penses-tu de cette évolution?
Je reste sceptique. Une étude affirme qu’il n’y a de bois disponible que pour une petite partie de ce qui est construit en Europe. Cela montre déjà le problème du discours sur la durabilité. Le sujet est souvent accompagné par une certaine hystérie sans lendemain – ce qui est aussi le cas des discussions portant sur le changement climatique. Il va de soi que nous devons nous en préoccuper et agir rapidement. Mais en tant qu’architectes, nous devrions y apporter des réponses par le biais de l’architecture, et participer ainsi à créer une culture architecturale. Le bois peut faire beaucoup, mais pas tout, loin de là. Si je poursuis l’idée de «créer des lieux» partout où j’interviens, alors je ne construirais pas partout une maison en bois. Ce qui est à mon avis déterminant, c’est la question de la disponibilité régionale du bois. Sans oublier que la forêt est plus qu’un simple espace économique.

stiva da morts, Vrin, 2003 | Photo: Lucia Degonda
Tu as travaillé avec de la pierre naturelle dans le cas de l’hôtel Maistra – un matériau très présent là-bas, mais qui a presque complètement disparu du répertoire architectural avec l’industrialisation de la construction. On l’a considéré à la fois comme complexe et coûteux pendant des décennies. Aujourd’hui, on calcule précisément la quantité de CO2 émise lors de l’extraction et du transport d’un matériau. Et il en résulte un regain d’intérêt pour la pierre, dont le bilan écologique est plutôt bon par rapport au béton ou aux pierres artificielles. Cela plaît à certain·e·s architectes, qui apprécient la sensibilité du matériau. Dans l’hôtel, la pierre a été utilisée pour les piliers. Est-ce là une tentative d’explorer des matériaux de construction locaux et plus durables?
À Pontresina, nous nous sommes d’abord demandé à quoi ressemblait un hôtel aujourd’hui et nous sommes mis en quête de références pertinentes. Après avoir pesé le pour et le contre, nous avons opté pour une construction hybride, dans laquelle la pierre naturelle joue également un rôle. C’est effectivement grâce à son bilan écologique que ce matériau de construction regagne du terrain. Et cela me réjouit. Même si le choix des matériaux est central dans la construction d’un lieu, nous ne devrions pas choisir une approche constructive et matérielle aux dépens d’une autre par simple principe. Nous devrions réapprendre à utiliser les matériaux à l’endroit où leurs propriétés sont le mieux mises en valeur.
Durant des décennies, plusieurs protagonistes ont plaidé pour la réintroduction des caractéristiques locales dans l’architecture moderne. Le débat sur la durabilité abonde-t-il dans ce sens? De nouveaux langages régionaux ou une plus grande sensibilité voient-ils effectivement le jour?
Ce serait bien. Mais la normalisation et le processus de rationalisation – entre autres par la collecte passive d’énergie solaire – me font plutôt croire le contraire. Ce n’est pas une critique de l’utilisation de l’énergie solaire; elle est indispensable. Mais pour l’instant, je constate plutôt que l’architecture est laissée pour compte, parce que la question des ressources et du CO2 attire toute l’attention et enflamme les avis, et que beaucoup se laissent guider par la peur. Les installations PV ne sont qu’un petit pas sur le chemin de la durabilité, même si ce pas est important. Mais c’est faire fausse route, c’est penser trop court. Dans la situation actuelle et confrontés à cette réalité, nous autres architectes devons essayer de faire progresser l’architecture et de réaliser des espaces et des ouvrages de qualité. Si nous parvenons à utiliser la technique comme un ennoblissement des caractéristiques locales, nous nous rapprocherons un peu plus de l’essence du lieu.
Comment cela peut-il se faire?
Par une plus grande sensibilité aux choses, aux matériaux, à la construction. Si je compare par exemple une construction en poutres avec une construction à colombage moins chère, j’y perçois une plus grande valeur. Les gens réfléchissent à deux fois avant d’abandonner une construction en poutres. Mais une construction à ossature avec montants continus bon marché est enlevée sans hésitation. Dans ce contexte, la commercialisation de la construction est un gros problème. Dès le moment où les gens ont remarqué que l’on pouvait gagner de l’argent en construisant d’une certaine manière, la culture du bâtiment a commencé à disparaître. Le commerce porte en lui un grand risque. L’économie, en revanche, est quelque chose de positif. L’économie, c’est faire des économies, et nous avons toujours dû en faire.
Mais tu ne fais pas un plaidoyer contre la construction industrielle, n’est-ce pas?
Nous ne reviendrons jamais à l’ancien mode de construction. Ce n’est pas possible. Aujourd’hui, on ne peut plus construire des bâtiments avec des murs en pierre naturelle de 80 centimètres d’épaisseur. Ce serait dispendieux en termes de matériaux et d’énergie, et occasionnerait des frais de transport élevés, sans compter l’émission de quantités incroyables de CO2.
Y a-t-il des questions, des champs thématiques ou projectuels que tu voudrais explorer ces prochaines années?
Le village idéal, peut-être. Difficile de dire si j’y parviendrais. Quand je repense à Vrin, j’avais de grandes attentes il y a 30 ans. Et tout ne s’est pas réalisé. Mais c’est aussi bien comme cela. Chaque début d’idée réclame une détermination claire: ce sera comme ça et pas autrement! Seule cette détermination crée quelque chose que l’on peut ensuite rejeter. Je procède de la même manière pour chaque mission. J’élabore une idée, puis essaie de la détruire en cours de route. Je dois et veux le supporter. Si l’idée ne tient pas la route, alors autant s’en séparer. Le jeu entre réalité et utopie est important pour moi. Il faut rêver. Si je ne fais que de l’utopie, je suis au chômage en tant qu’architecte. Mais si je ne travaille que sur la réalité, je suis ennuyeux.
Peux-tu décrire comment tu le concevrais ce village utopique?
Avec plus d’intuition et moins de raison. L’intuitif est souvent plus intéressant que le rationnel. La raison, c’est de travailler selon des règles et des normes. L’intuitif se nourrit lui de l’instinct. Beaucoup de lieux qui nous stimulent ont été créés intuitivement. À Vrin, on a construit une maison, puis une autre, et il fallait bien passer entre les deux. Les rues n’ont pas été planifiées, mais elles sont malgré tout bien placées. Et puis les habitant·e·s ont eu besoin d’un espace religieux. Celui-ci avait un aspect très différent de ce qui existait déjà. Une hiérarchie s’est formée. Cette forme hiérarchique m’intéresse, car elle ordonne la vie. Impossible, bien sûr, de reproduire cela parfaitement tout de suite. Tout est devenu plus complexe, voire trop compliqué dans un bon nombre de cas.

Tour d'observation, parc animalier Goldau, 2016 | Photo: Lucia Degonda
Pour qu’un nouveau village ait les qualités que tu as décrites, ne devrait-il pas ainsi se développer sur plusieurs années et refléter les besoins et souhaits de la communauté?
Bien sûr, tu as raison. Ta question illustre bien les limites de la planification et de l’architecture. Et malgré tout, nous ne devrions pas cesser de croire à des idéaux. Cela reste une quête de vérité. La recherche du beau est la recherche de la vérité. Une vérité que l’on ne trouvera jamais, mais que nous continuerons de chercher. Il faut le supporter. Et nous parviendrons bien, ici ou là, à créer un collectif pour des lieux de qualité – des lieux propres à s’émerveiller.
Un grand merci pour cet entretien passionnant. Nous nous réjouissons de te voir présenter tes projets et ton travail en cours aux lecteur·rice·s de Swiss Arc lors d’un événement en 2025.
Première publication dans Swiss Arc Award Mag 2024–6. Commandez votre exemplaire sous: swiss-arc.ch/services/commander-le-magazine
Vous pouvez télécharger ici la discours à la louange de Roger Boltshauser.