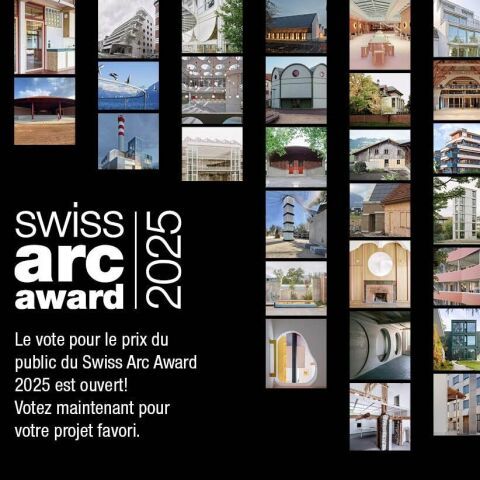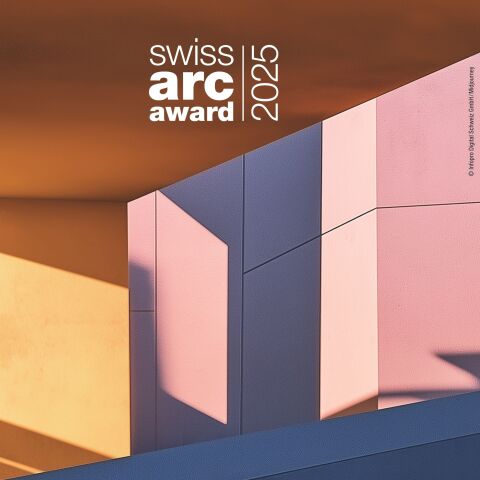Voir, toucher, sentir, ressentir – impressions du jury de l'Arc Award 2024 sur le voyage

Elisa Schreiner, Mina Faas, Pascal Flammer, Philipp Scheidegger, Manuel Herz, Roger Boltshauser et Ludovica Molo admirent le bâtiment D de l’Hobelwerk à Winterthur. | Photo: Jørg Himmelreich
Quel projet a été votre point fort personnel et quel aspect vous a le plus surpris sur le terrain?
Dominique Salathé Visiter les bâtiments sur place est toujours incroyablement enrichissant. Nous devrions d’ailleurs prendre encore plus de temps pour cela. Car c’est seulement en vivant réellement les espaces que l’on comprend les architectures; les images, textes et plans soumis ne sont en fin de compte que des promesses. Ce qui m’a particulièrement impressionné lors de ce voyage, c’est la diversité des projets. Il m’est donc difficile de n’en sélectionner qu’un.
Ludovica Molo Je partage complètement cet avis. Les lieux que nous avons visités témoignent d’une Suisse de plus en plus densément peuplée, où les architectes expérimentent de nouvelles formes d’utilisation des espaces. Ils racontent l’histoire d’un pays qui, face aux défis actuels, cherche une nouvelle urbanité, la revitalisation de ses zones périphériques et une gestion durable des ressources. Qu’il s’agisse d’un nouveau quartier ou d’un atelier pour mère et enfant en milieu alpin, un des grands thèmes qui ressort est le vivre-ensemble, la relation entre le logement et le travail, ainsi que le désir de communauté. Nous avons été étonnés par la multitude d’idées exprimées et comment elles sont articulées et développées, presque comme s’il existait des milliers de bonnes réponses à ces questions. Tous ces projets partagent un aspect social qui détermine la culture et la qualité de la construction. Il me semble que notre voyage nous a conduits vers une variété de projets inspirants, empreints de soin et d’engagement, chacun montrant un chemin vers l’avenir.

Ludovica Molo lors de la visite du château de Neu-Aspermont à Jenins | Photo: Mina Faas
Ludovica, vous êtes impliquée depuis la première cérémonie des Arc Awards et avez suivi ses évolutions. Comment, selon vous, le prix d’architecture et ses priorités ont-ils évolué?
LM En douze ans, tout a changé et rien n’a changé. 2012 semble loin, et le monde est frappé par des crises qui se succèdent à un rythme effréné: de la crise sanitaire à la crise géopolitique, sans oublier la crise énergétique et la crise climatique. Bien que l’on parle de cette dernière depuis plus de cinquante ans, elle semble seulement maintenant vraiment entrer dans la conscience publique. Notre regard sur l’avenir a évolué et remet en question de nombreuses certitudes. C’est notamment la manière dont nous exerçons notre métier qui est mise à l’épreuve. Des thèmes tels que la réutilisation et l’économie circulaire dominent le discours, alors même que notre conception de ce qui constitue une bonne architecture a évolué. Le spectre des interrogations est désormais beaucoup plus large, allant au-delà du simple bâtiment, incluant des développements urbains complets ainsi que des interventions plus modestes lors de restaurations. Je nous sens aujourd’hui plus ouverts, peut-être même moins dogmatiques en ce qui concerne la diversité des langages architecturaux. En comparaison avec 2012, les exigences en matière d’engagement social, politique et éthique des projets sont beaucoup plus élevées. Cela me semble être une condition essentielle pour garantir la qualité. Mais parfois, à y regarder de plus près, nous réalisons aussi que rien n’a changé , ou trop peu, et que certains projets ne répondent pas aux attentes.
Les professionnels de l’architecture sont désormais appelés à jouer un rôle plus actif en tant qu’acteurs politiques et sociaux, au-delà de simples prestataires de services. Existe-t-il des opportunités pour créer de la valeur sociétale, et sont-elles suffisamment revendiquées?
Manuel Herz En tant qu’architectes, nous savons que nous avons une responsabilité sociale qui dépasse la simple satisfaction des fonctions. Ce n’est pas un phénomène nouveau, mais plutôt un élément intégral de notre discipline. La conscience de cette responsabilité chez nos collègues est un facteur de qualité essentiel. Ce qui a peut-être changé ces dernières années, c’est l’urgence de cette responsabilité, notamment en ce qui concerne les ressources. Les bâtiments consomment environ 40 pour cent de l’énergie et des ressources. Cela montre clairement l’énorme impact que notre profession a sur l’environnement, la société et le monde. C’est en réalité une merveilleuse opportunité, car nous sommes conscients de l’importance de notre travail. En Suisse, probablement la démocratie la plus riche du monde, nous avons l’obligation d’assumer et de revendiquer cette responsabilité. Tout cela a déjà commencé, mais il y a encore des progrès à faire.

Dominique Salathé, Ludovica Molo, Roger Boltshauser et Manuel Herz en compagnie de Stephan Buehrer et Martina Wuest lors de la visite du centre d’entretien ENO à Rümlang | Photo: Jørg Himmelreich
La question circulaire revient dans de nombreux projets favoris. La durabilité constitue-t-elle une restriction à la liberté créative des architectes, ou sera-t-il de plus en plus nécessaire d’intégrer des éléments de réutilisation comme un collage harmonieux?
DS La réutilisation est aujourd’hui une évidence. Les projets en lice abordent cette question de différentes manières. La durabilité ne doit en aucun cas être perçue comme une restriction à la liberté de création. Au contraire! La gestion de l’existant, des nouveaux matériaux et/ou des éléments de construction réutilisés ouvre de nouvelles possibilités. L’architecture en devient plus riche et plus nuancée. Quelles stratégies concrètes seront les plus prometteuses, cela reste à voir. Il est cependant indiscutable que nous devons apprendre à aborder de nouvelles problématiques de manière ouverte et à les envisager comme des opportunités plutôt que comme des contraintes.
Malgré la densification continue des villes suisses, le manque de logements persiste. La sélection de cette année propose-t-elle des solutions prometteuses?
Roger Boltshauser J’ai été particulièrement impressionné par certains projets de coopératives. La combinaison de formes de logement variables avec des espaces communautaires fonctionnels aboutit à des réponses architecturales surprenantes. Je pense par exemple à des salles communes conçues comme des circulations, des couloirs ou même des serres. En tant que lieux de rencontre pour les résidents, ces espaces peuvent être à la fois spacieux ou intimes. Selon la saison, les fruits et légumes sont prêts à y être récoltés, ce qui appelle à un véritable engagement collectif. Il est passionnant de voir comment de plus en plus de changements d’usage sont envisagés, permettant ainsi la création d’espaces de vie animés et attrayants.

Manuel Herz et Dominique Salathé dans la maison d’habitation et atelier Lind à Urmein | Photo: Elisa Schreiner
Cette année, en plus des projets suisses, quelques projets internationaux figurent parmi les favoris. Assiste-t-on à une ouverture de l’architecture suisse à l’international?
MH Le fait que les bureaux d’architecture suisses soient actifs à l’international n’est pas un phénomène nouveau. Pensons seulement à Hannes Meyer ou à Domenico Trezzini, dont le travail à Saint-Pétersbourg au 18ème siècle avait déjà une dimension très internationale. La Suisse est un pays relativement petit avec des frontières étroites. Tôt ou tard, nous intégrons ces éléments dans notre travail, d’où l’aspiration de certains bureaux d’architecture suisses à avoir un portfolio international ou à collaborer avec des collègues étrangers. Cette année, nous avons vu de beaux projets internationaux. Je constate cependant une tendance inverse: de nombreux bureaux cherchent de plus en plus à se concentrer exclusivement sur la Suisse. Une raison de ce «nouveau régionalisme» repose sur une prise de conscience écologique accrue. L’idée est de ne pas avoir à voyager et de travailler là où l’on connaît les matériaux locaux et le savoir-faire. Une autre raison est probablement d’ordre financier: les honoraires à l’étranger sont généralement plus bas, ce qui rend difficile la possibilité de construire en dehors de la Suisse.
Il existe d’excellents exemples de bureaux d’architecture qui se concentrent sur le local ou le régional. L’un d’eux sera récompensé dans la catégorie loisirs & lifestyle. Mais nous devons veiller à ce que le régionalisme ne devienne pas une introspection, conduisant à un sentiment de supériorité. Pour ma propre pratique, le champ d’action international et la remise en question de ma propre position sont d’une importance capitale.
Dans la catégorie Next Generation, en 2024, nous ne récompensons plus des travaux d’étudiant·e·s individuels, mais des studios de conception proposés par les écoles d’architecture suisses. En quoi cette initiative, qui vise à reconnaître le travail collaboratif des professeur·e·s, des assistant·e ·s et des étudiant·e·s, porte-t-elle ses fruits?
Ludovica Molo Étant donné le paradigme en évolution de notre société, il est logique d’élargir le débat aux écoles d’architecture. Ces établissements, véritables pépinières d’idées avec une vision privilégiée de l’avenir, sont idéalement placés pour relever ce défi. Là où la prochaine génération est formée, ils se transforment en terrains d’expérimentation, permettant des réflexions moins conventionnelles et parfois même plus radicales. La nouvelle catégorie Next Generation met donc l’accent sur la didactique, en honorant les enseignants et leur engagement souvent de plusieurs décennies. Ces dernières années, les établissements d’enseignement supérieur ont connu une transformation profonde dans leur quête de stratégies et d’outils pour répondre à des questions sociétales pertinentes. Cela concerne non seulement les thèmes abordés et une ouverture accrue à d’autres pratiques et disciplines, mais également une vision élargie des enjeux globaux en adoptant des approches inclusives. Dans cette perspective, le prix est à comprendre comme un travail d’équipe et non comme un accomplissement individuel: c’est une reconnaissance pour tous les membres de la communauté académique qui s’engagent ensemble sur un chemin d’apprentissage et de croissance.

Dominique Salathé, Ludovica Molo, Elisa Schreiner, Manuel Herz et Mina Faas au Kunsthaus Baselland à Münchenstein | Photo: Jørg Himmelreich
Cette nouvelle catégorie se positionne comme une vitrine de l’enseignement actuel en Suisse. Quels sont les sujets les plus fascinants qui émergent des studios de design soumis, et ces questions générales répondent-elles aux exigences de la prochaine génération d’architectes?
DS Les écoles apprennent rapidement et s’adaptent avec agilité aux nouveaux enjeux. Un aspect intéressant est que certaines missions de conception sont développées de manière plus conceptuelle et abstraite, tandis que d’autres mettent l’accent sur la pensée constructive en architecture. Le paysage universitaire est en mouvement, avec des positions qui élaborent de nouvelles stratégies et transmettent une culture de conception sans œillères. Il est frappant de voir à quel point les ateliers abordent de nouveaux thèmes de manière proactive. Que ce soit la réutilisation des matériaux de construction, l’exploration des cycles alimentaires, la construction vernaculaire ou l’utilisation de nouveaux matériaux, tout cela fait partie de l’architecture, et chaque direction de pensée est expressément permise.

Daniel Buchner a presenté le lotissement Rötiboden à Wädenswil. | Photo: Jørg Himmelreich
Roger Boltshauser, les projets soumis par les écoles suisses montrent la créativité des futurs architectes et tournent autour de concepts à valeur sociale, de réutilisation et de durabilité. Cette année, nous honorons également, pour la première fois, une personnalité avec le Lifetime Achievement Award, qui a influencé le discours architectural par des solutions novatrices. Dans le rapport entre jeunes et expérimentés, où se rejoignent les concepts et les priorités, et où diffèrent-ils?
RB Aujourd’hui, il est essentiel de se pencher sur les ressources locales et sur la manière dont celles-ci peuvent être exploitées pour permettre une construction réduisant les émissions de CO2. Tant les jeunes équipes de recherche que les bureaux établis examinent des approches pratiques concernant l’existant et comment celui-ci peut être réutilisé ou densifié. La recherche de solutions inclut également l’évolutivité des systèmes de construction et des modèles de programmation. Le potentiel architectural des deux groupes n’est pas statique; il doit être continuellement réévalué. Ce qui est gratifiant, c’est de constater que les jeunes architectes considèrent ces questions comme allant de soi. Les bureaux avec une longue expérience en sont également conscients, même si, lorsqu’ils sont confrontés à de plus grands projets, il peut être difficile de les prendre en compte de manière adéquate. Le Lifetime Achievement Award rend hommage à Gion A. Caminada, dont l’approche et la philosophie en matière de construction locale et de préservation des ressources sont exemplaires depuis des décennies, tout en proposant des solutions pratiques. De plus, il s’engage fortement en faveur des préoccupations sociales et économiques qui sont vitales pour sa région. Ainsi, Caminada incarne un modèle de construction durable et tournée vers l’avenir, et son travail inspire aussi la prochaine génération.
Le jury
Roger Boltshauser
est fondateur du bureau Boltshauser Architekten à Zurich ainsi que de Boltshauser Architektur à Munich. Il est professeur à l’EPF de Zurich et membre du Baukollegium de Berlin.
Manuel Herz
est fondateur de Manuel Herz Architekten à Bâle. Jusqu’en 2020, il était professeur de recherche à l’université de Bâle et a enseigné à l’ETH Zurich ainsi qu’à la Harvard Graduate School of Design.
Ludovica Molo
est directrice de l’Institut international d’architecture de Lugano et co-fondatrice de studio we à Lugano. De 2016 à 2024, elle a présidé la Fédération des architectes suisses FAS.
Dominique Salathé
est fondateur du bureau d’architecture Salathé Architekten à Bâle. Depuis 2004, il est professeur à l’Institut d’architecture de la FHNW et a enseigné en tant que professeur invité à l’EPF Lausanne.
Première publication dans Swiss Arc Award Mag 2024–6. Commandez votre exemplaire ici