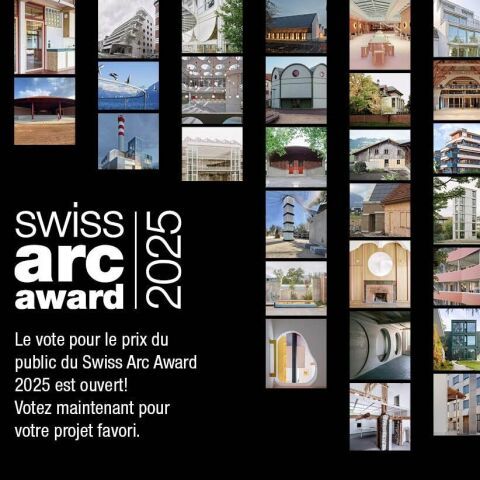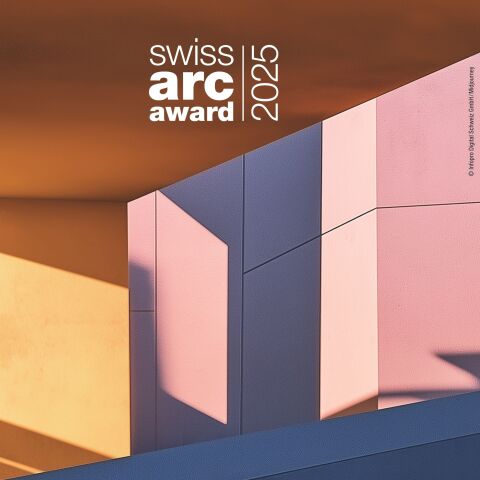Lifetime Achievement Award 2025 – Kaschka Knapkiewicz et Axel Fickert en conversation avec Jørg Himmelreich

Kaschka Knapkiewicz & Axel Fickert | Photo: Daniel Villiger
L’œuvre architecturale des Zurichois Kaschka Knapkiewicz et Axel Fickert se caractérise par un remarquable équilibre entre esthétique, fonctionnalité et sensibilité au contexte. Avec leurs réalisations à Zurich et dans ses environs, Knapkiewicz & Fickert ont apporté une contribution précieuse à l’architecture contemporaine depuis les années 1990 et influencé des générations d’architectes.
Jørg Himmelreich La rédaction vous félicite chaleureusement pour ce Lifetime Achievement Award. Nous aimerions profiter de cet entretien pour aborder différents aspects de votre production architecturale, évoquer les thèmes et les questions qui ont marqué votre travail et ce qui vous préoccupe actuellement. Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours personnel et professionnel respectif?
Kaschka Knapkiewicz Je suis née et j’ai grandi à Winterthour. Mon père était un interné polonais, et ma mère était originaire du Tösstal. J’ai étudié l’architecture à l’ETH. C’est là que j’ai rencontré Axel. Puis, j’ai passé trois ans à Londres, travaillant notamment chez Zaha Hadid, où j’étais sa première employée. Par la suite, j’ai séjourné quelque temps à Berlin avec mon compagnon de l’époque.
Axel Fickert Je suis quant à moi originaire d’un village en Bavière orientale, près de la frontière tchèque. Je vis en Suisse depuis 52 ans. J’ai également étudié à l’ETH Zürich. Lorsqu’on vient de loin, on reste en quelque sorte un étranger.

Lotissement Hornbach, Zürich, 2021 | Photo: Seraina Wirz
Pourquoi insistes-tu là-dessus?
AF Je veux dire par-là que l’on peut vivre une éternité en Suisse sans jamais vraiment s’y sentir chez soi. Mais cette incertitude permanente liée à la quête d’identité est en fait une bonne chose. Au début, j’enviais celles et ceux de mes ami·e·s qui avaient une identité bien définie. Les Lucernois·e·s se distinguaient particulièrement à cet égard, avec leur enracinement régional d’une part et la possibilité de se référer à une architecture d’autre part, à l’image de la version lucernoise des cabines de plage ligures. Moi, en revanche, j’étais toujours en quête. Où est ma place? À quoi puis-je me raccrocher? Et cette quête d’un vecteur d’identité n’a en fait jamais cessé. Même si elle n’a jamais été tout à fait la mienne en raison de mon départ précoce, j’ai à un moment donné essayé de monter un mythe autour de mon ancienne patrie. Une sorte de roman ou de pièce de théâtre pour lequel j’ai développé un décor avec lequel je pouvais travailler. Cela m’a par la suite aidé à développer la capacité de très bien m’accommoder d’autres décors.
Vous avez étudié en même temps à l’ETH. Qui étaient vos enseignant·e·s ou vos modèles, et quels sont les thèmes et approches qui vous ont marqué?
KK Le Corbusier et plus tard Aldo van Eyck m’ont beaucoup intéressé. Ce dernier enseignait à l’ETH. Sa manière de parler d’architecture et de la développer, ses critiques imagées et toujours très claires de nos travaux m’ont à l’époque donné des impulsions qui m’accompagnent aujourd’hui encore. J’étais également fasciné par l’architecture classique – par Karl Friedrich Schinkel, John Soane et Leo von Klenze. Axel était différent. Concevoir et dessiner? Il trouvait ça un peu bizarre et n’a fait ses premiers plans qu’au moment de son diplôme.
AF J’ai quand même dessiné quelques plans avant. Mais j’ai surtout écrit à la machine à écrire pendant mes études. Si notre époque n’était pas révolutionnaire, elle était en tous cas très agitée. Comme beaucoup d’autres, je ne m’intéressais pas à la forme de l’architecture, mais plutôt aux questions sociales. J’étais d’avis que l’architecture ne pouvait rien changer et qu’elle n’était pas en mesure de contribuer à quoi que ce soit. Je suis un peu étonné de constater que la même chose se produit à l’heure actuelle: l’architecture fait de la figuration et seule la société compte.
KK Nous nous connaissons depuis 1972 mais n’avons pas travaillé ensemble au début. Ce n’est qu’en 1992 que nous avons fondé notre bureau à Zurich. Nous avons toujours été un peu en opposition. Mais c’est aussi ce qui a nourri et continue de nourrir de nombreuses discussions communes.
AF Nous avons étudié dans le bâtiment principal de l’ETH, au centre de Zurich. La vieille ville avec ses bars n’était pas loin. On peut dire que c’est dans les bars que nous avons appris à nous connaître, en débattant de nos idées – à la buvette de l’hôtel Zum Storchen notamment, qui était très différente de ce qu’elle est aujourd’hui.
Mais, visiblement, tu as quand même fini par te mettre à dessiner, Axel.
AF Cela a pris un certain temps. Un tournant dans mes études est survenu lorsque Aldo Rossi a été nommé professeur invité à l’ETH. Ça a été le coup de foudre. C’est lui qui, avec ce vent de nouveauté qui l’accompagnait, m’a mené vers l’architecture. Paul Hofer aussi a joué un rôle important. Il enseignait l’histoire de l’urbanisme et a éveillé notre intérêt pour la ville historique en nous transmettant une connaissance approfondie de celle-ci. Nous avons réalisé un relevé, un plan d’ensemble similaire au plan de Zurich que Rossi avait fait dessiner, mais de Soleure. Cela m’a donné une excellente base pour tout ce qui a suivi. Cela dit, c’est bien Kaschka qui m’a fait découvrir de nombreux joyaux de l’architecture.
Qu’est-ce qui vous a rétrospectivement le plus marqué dans l’enseignement de Rossi?
AF Selon Rossi, l’historicité de l’architecture la rend autonome, c’est-à-dire qu’elle se reproduit toute seule. Et il nous a aussi montré que l’aspect social a toujours été présent dans l’architecture, qu’il en fait partie intégrante, depuis des siècles, voire des millénaires. Il ne disait pas que l’architecture est complètement figée, mais plutôt qu’elle évolue lentement et continuellement avec la société. À l’époque, beaucoup pensaient que l’architecture était en quelque sorte le produit dérivé d’autres disciplines et trouvaient provocante cette idée d’une discipline à part entière. Nous sommes toujours attachés à cette idée. Nous ne cherchons pas à savoir si nos constructions sont des lieux de rencontre ou si elles encouragent l’appropriation. Si ces aspects sociologiques sont de nos jours mis en avant de manière plus affirmée, nous avons en toujours tenu compte.
Et la deuxième chose sur laquelle je suis d’accord avec Rossi, c’est qu’il n’y a rien de nouveau. Il n’y a que des interprétations contemporaines de phénomènes très divers. Et tant que l’homme ne sera pas remplacé par des robots, il aura toujours les mêmes besoins: dormir et se nourrir. J’en déduis que la société humaine et ses besoins en matière d’urbanisme et d’architecture sont relativement constants. De nouvelles formes de société ont souvent été imaginées et expérimentées, sans avoir jamais vraiment fonctionné. Les appartements en cluster, dont on parle beaucoup actuellement, ne sont pas une nouveauté: il s’agit en réalité d’une structure qui existait déjà dans les appartements des palais vénitiens.

Entrée couverte vers l’Europaallee, Zurich, 2017 | Photo © SBB CFF FFS
KK Colin Rowe et son livre «Collage City», paru à l’époque où Rossi enseignait à Zurich, comptait aussi beaucoup à nos yeux. Il montrait comment assembler des éléments anciens et nouveaux pour construire de nouvelles spatialités urbaines par collage. La mise en valeur de bâtiments importants dans l’espace urbain – les monuments publics – était également un thème abordé.
AF Tout comme Rossi, Rowe évoquait les hiérarchies fortes dans la ville, ou encore de la coexistence du plus important et du plus général. C’est une bonne chose qui perdure encore aujourd’hui. Notre intérêt pour les vieilles villes n’a jamais faibli, bien au contraire. Notre lecture de la ville est restée similaire et nous aide toujours dans notre travail. Elle nous empêche de nous enliser dans une vision trop actuelle, plutôt diffuse, de l’urbanisme, comme je la ressens parfois aujourd’hui.
Pour Rossi comme pour Rowe, le recours à des références était une thématique importante qui reste centrale dans votre travail. Voulez-vous nous en dire plus à ce sujet?
KK Nous avons dès le début essayé de réunir tout ce qui nous fascine. Nous partageons une immense collection de souvenirs – des fragments de différentes époques et de différentes villes. Lorsque nous construisons un bâtiment dans une situation particulière ou que nous sommes confrontés à un problème concret, des souvenirs apparaissent spontanément. Il faut alors se les remémorer plus précisément. Une maison avec un auvent, peut-être, la position d’un bâtiment par rapport à la rue, une entrée avec une couleur, une ombre... et l’on se demande alors: pourquoi se souvient-on précisément de cette maison ou de cet endroit? Quel est le rapport avec ce que nous voulons créer? Il en résulte souvent des équations qui cachent parfois leur lot de surprises. Jamais cependant nous ne copions quelque chose dans son intégralité: nous cherchons à en extraire l’essence pour ensuite la transposer. Cela dit, il nous arrive parfois d’insérer des citations directes, des spolia intellectuels, sans que cela devienne une contrainte.
AF La référenciation enrichit notre travail. Mais cela peut aussi constituer un problème. Si l’on réfléchit à ce qui convient à un lieu, que l’on fait quelque chose de similaire et que l’on continue sur cette lancée, on court le risque de simplement confirmer ce lieu tel qu’il est. Et ce n’est pas une mauvaise chose à première vue. L’adaptation est en effet un grand sujet aujourd’hui. Est-ce la bonne approche? Difficile de se prononcer. Car si le lieu a des qualités auxquelles se référer, c’est là que ça se complique.
Pour l’ensemble Guggach II (2020) à Zurich, nous nous sommes par exemple inspirés de ce que d’autres avaient déjà mis en place. Comme pour Guggach I, où EMI avait réalisé une cour de très grande dimension, notre projet s’articule autour d’une grande cour. Ce n’est donc pas une nouveauté.
Mais je reconnais qu’il faut souvent implanter quelque chose qui n’a pas sa place dans un lieu pour lui donner une nouvelle dimension. Une référence qui ne lui correspond pas, qui n’est pas non plus complètement tirée par les cheveux, mais qui n’existe pas là et qui introduit une nouvelle dimension. Je prends pour exemple l’îlot Klee à Zurich-Affoltern (2011): si l’on s’était contenté de se demander ce qui convenait à cet endroit, on n’aurait jamais eu l’idée de créer une grande cour. Elle est étrangère au lieu. Mais c’est précisément cette caractéristique distinctive qui l’a transformé et amélioré. Rien de tout ce qui a été construit autour ne l’a été de la même manière.
C’est encore plus flagrant dans le cas du quartier Vogelsang à Winterthour (2022). Il s’agit d’une typologie ou d’une morphologie totalement étrangère par rapport à ce qui se fait habituellement dans cette ville. Ce concentré spatial a quelque chose d’une petite ville, d’une vieille ville ou d’un village. Et cela a influencé le lieu de manière positive, grâce à un ensemble qui se démarque de l’anonymat banlieusard.
J’aimerais m’attarder sur ces cours. Vous consacrez beaucoup d’attention aux espaces semi-publics qu’offrent vos ensembles de logements, et à leur ancrage dans l’espace public. Un équilibre entre générosité et intimité est instauré, qui semble important à vos yeux. L’intérêt hérité de vos études pour le discours sociologique inspire-t-il toujours ces champs de réflexion?
KK Pour moi, la sociologie ne se résume pas à lire des textes et à accumuler des théories sur la vie en société, même si j’apprécie entre autres beaucoup Socrate, les philosophes antiques et les drames. Le plus passionnant, c’est d’observer les gens avec empathie, c’est-à-dire la «vie» tout simplement.
AF Nous nous sommes toujours intéressés à la communauté et à la vie en général. Tous nos projets le reflètent implicitement. Nous ne le mettons pas au premier plan, mais cet intérêt est toujours présent lorsque nous discutons de la forme. Prenons par exemple la cour de l’îlot Klee. Une cour ne doit pas occulter ou exclure l’environnement. Si nous avions simplement créé une cour rectangulaire, avec l’idée d’une forme autonome qui ne se réfère qu’à elle-même, le résultat n’aurait pas été aussi satisfaisant. Au lieu de cela, nous avons déformé la cour et créé des renfoncements qui forment en quelque sorte des cours tronquées qui offrent des points de connexion vers l’extérieur et imbriquent cette figure vide dans son environnement.
Guggach présente aussi des cours tronquées qui se projettent vers l’extérieur à la manière de tentacules et esquissent la naissance de cours plus larges. Vogelsang est similaire: son plan articule des bras en forme de R orientés dans différentes directions. Ils sont comme des ventouses fixant des points d’ancrage périphériques pour mieux tisser un lien avec l’espace environnant et ouvrir simultanément la forme bâtie.

Lotissement Guggach II, Zürich, 2020 | Photo: Seraina Wirz
KK Il est important de mentionner que Vogelsang a deux visages différents. Côté voie ferrée et route, la façade modelée très linéaire et pourtant rythmée par des parties saillantes de trois étages, renvoie l’image d’un ensemble architectural cohérent. Côté jardins ouvriers, l’ensemble est composé en assemblant des parties beaucoup plus petites, articulées comme des bras s’étendant vers la verdure, comptant au maximum trois étages et ressemblant à des maisons individuelles. Ce jeu avec les échelles est à la fois stimulant et amusant.
Le cachet des appartements de nos projets est inspiré par leur situation, par l’urbanisme. Ils ne sont jamais identiques d’un projet à l’autre. En d’autres termes, c’est l’espace extérieur qui détermine leur qualité spécifique. Le quartier et les environs influencent leur intérieur et leur espace extérieur privé – jardin, balcon, loggia, etc. Et ceux-ci influencent à leur tour les parties communes. Sans eux, l’espace extérieur commun ne peut pas fonctionner. Si un appartement ne dispose pas d’un bon espace extérieur privé, l’espace collectif ne fonctionnera pas non plus.
Quel projet illustre ça en particulier?
KK Nous nous demandons toujours: pour quelles raisons emménager dans Klee, à Affoltern dans la périphérie? À part la cour articulée, qu’est-ce qui rend ces appartements si spéciaux? Nous étions convaincus qu’il fallait, par exemple, des espaces extérieurs privés beaux et spacieux qui ne perturbent pas la cour et son atmosphère. Ces espaces sont essentiels et se déploient sur deux étages en renfoncement. L’appartement du bas jouit de cette loggia en double-hauteur, alors que l’appartement du haut dispose d’un grand balcon en saillie, qui ne gêne pas celui du bas. Selon leur exposition au soleil, ces loggias donnent sur la cour ou sur l’extérieur, en direction du quartier. Cela singularise les séjours situés à l’arrière et engendre un plan d’étage profond.
AF Tout cela nous a amenés à réfléchir à la possibilité d‘inverser l’organisation d’un appartement ou d’une maison. L’espace extérieur privé est généralement un appendice, un supplément, proéminent ou semi-encastré. Peut-il devenir un thème central, ce qui conduirait à une mutation de l’espace extérieur d’autant plus significative et nécessaire face au changement climatique. Pouvoir profiter de l’extérieur va devenir un enjeu important, voire majeur, de l’évolution du caractère de l’ensemble du concept d’habitation. Dans la maison privée construite par Kaschka à Uesslingen, la loggia est un élément important qui détermine toute la maison. Elle est en fait la maison.
KK Les balcons extérieurs de l’ensemble Hornbach forment des tours en partie encastrées dans la façade pour former à l’intérieur des encorbellements inversés, une particularité que l’on retrouve dans les maisons du XIXe siècle présentes dans le quartier. L’arrondi marque la spatialité de chaque appartement, et leur vitrage protège du bruit de la Seefeldstrasse tout en constituant un élément distinctif vers l’extérieur. À l’intérieur, les facettes des balcons agissent sur la forme des vastes séjours et des chambres. Le fait que l’extérieur donne des impulsions aux pièces situées derrière est une caractéristique commune à tous nos ensembles, et c’est aussi le cas à Guggach.

Lotissement Vogelsang, Winterthour, 2022 | Photo: Andrea Helbling
Ce qui frappe dans votre travail, c’est le courage de travailler à grande échelle.
AF On nous a souvent critiqué à ce sujet, et aussi pour l’expression affirmée de nos projets. C’est lié au fait que nous aimons la ville européenne classique Milan, Vienne, Saint Pétersbourg, Venise, Paris ou encore Turin – Berne et ses arcades aussi, du reste.
KK La grande forme et les situations spatiales marquantes aident à particulariser le lieu et permettent aux habitant-es de s’identifier à leur quartier. Ils doivent être en mesure de dire: «C’est là que j’habite, c’est là que je me sens chez moi.» Ce sont des lieux où l’on se retrouve.
On aimait les grands gestes dans les années 1960 et 1970. On les a ensuite critiqués pour leur anonymat. Tous les appartements se ressemblaient, sans hiérarchie ni caractéristiques distinctives. Vos projets, en revanche, se démarquent délibérément à la petite échelle, à l’échelle humaine, en faisant de chaque unité une adresse à part entière et en leur attribuant des caractéristiques originales – avec des niches, des loggias et des encorbellements.
AF Imaginons un bâtiment avec des milliers de fenêtres toutes identiques et standardisées. Il est impossible de les identifier comme des lieux individuels. Le recours à des hiérarchies marquées peut remédier à cela. L’histoire nous offre d’ailleurs de magnifiques exemples d’ensembles, comme le Marxhof à Vienne. Malgré sa grande taille, de nombreux lieux distinctifs permettent de s’y orienter: avant-corps, tours, arches... C’est pareil à Saint-Pétersbourg où l’on trouve des bâtiments gigantesques avec des portiques imposants de douze colonnes, alors que six auraient suffi: l’expression a été poussé à l’extrême.
C’est ce que nous essayons aussi de faire. Prenons l’exemple de Klee et ses façades aux proportions colossales. La hauteur moyenne de sept étages qui rend le bâtiment si imposant est réduite visuellement en regroupant deux étages pour n’en faire que trois plus un rez-de-chaussée. Ou nous cherchons à créer des lieux spécifiques, à l’organisation particulière, qui se démarquent d’une manière ou d’une autre, ce dont témoigne bien l’ensemble Hornbach.
KK Ce qui posait problème dans les grandes formes des années 1960, par exemple dans les constructions de Le Corbusier, c’était qu’il s’agissait d’objets isolés. Un ami les appelle toujours des «trophées». L’image est juste et colle bien à ces immenses constructions, tours ou barres, placées les unes à côté des autres, formant parfois un ensemble sans spatialité bien définie. Je pense aux Robin Hood Gardens de Alison et Peter Smithson à Londres (1972), qui ont été démolis depuis. C’était un beau bâtiment, avec des appartements superbes et de magnifiques détails. Mais c’était un objet qui ne s’intégrait pas à son environnement. Pour que ces grands volumes modernes créent des entre-deux, il en faut un grand nombre, comme à New York ou à Chicago par exemple. Nous essayons par conséquent d’éviter de faire des trophées. Nous voulons que nos bâtiments soient en relation avec leur environnement et qu’ils forment un espace, qu’il y ait des espaces intermédiaires qui agissent comme des aimants. Comme à Frohburg, où les bâtiments ressemblent à des parenthèses qui se font face, se regardent, se réfèrent les unes aux autres et s’ouvrent à nouveau – à l’image des crescents – pour former de grands espaces paysagers. Plusieurs bâtiments ne font ainsi plus qu’un – même s’il y a des respirations entre eux. C’est une autre façon de cadrer l’espace.
AF La tendance de la Modernité était naturellement différente. Elle était axée sur l’objet qu’elle juxtaposait librement avec d’autres objets. C’est exactement ce que nous ne faisons pas. Nous sommes plutôt classiques et recherchons la correspondance. La juxtaposition doit être harmonieuse. Il faut sentir que l’on veut créer un espace, et cela ne peut pas se faire n’importe comment.

Immeuble résidentiel Lokomotive, Winterthour, 2006 | Photo: Michael Lio
Vous avez utilisé tout à l’heure le mot «expression».
AF Nous parlons d’expression parce que nous sommes d’avis qu’il en faut un minimum pour que l’on ressente quelque chose. Si tout s’apparente à une suggestion minimale, bien des choses vont rester cachées. Beaucoup trouvent que la neutralité est la bonne approche, que c’est elle qui va permettre aux spectateur·rice·s de développer leurs propres associations et sentiments. Nous croyons au contraire qu’il faut être stimulé. Et cette stimulation passe par une expression qui doit être claire. C’est comme au théâtre. Il faut qu’il y ait des déclencheurs d’émotions.
KK Et au niveau du détail, nous essayons de créer une certaine diversité. Mais les différences ne doivent pas être si évidentes. C’est formidable quand on découvre après dix ans qu’une fenêtre diffère légèrement des autres, qu’un angle est légèrement différent ou qu’un balcon légèrement décalé... Ce sont donc des nuances très subtiles. Mais elles sont très importantes à cette échelle, car elles déterminent la façon dont les habitant·e·s se sentent dans une grande cour ou un grand bâtiment. Où se sent-on fort, grand et accepté? Et où est-ce l’inverse? Où est-ce repoussant, froid et formel? Serlio a conçu des images urbaines pour la comédie, la tragédie et la campagne. À certains endroits de la ville, le formel et sa capacité à rendre plus neutre est important, tandis qu’à d’autres, c’est plutôt le ludique qui prime, pour sa capacité à rendre proche. Ce sont des décors ou des scènes, comme Axel l’a dit au début.

Immeuble résidentiel Lokomotive, Winterthour, 2006 | Photo: Walter Mair
Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous travaillez avec les matériaux?
KK Beaucoup de collègues pensent que le fait de réduire le plus possible est une bonne solution, aussi pour des raisons de coût. Nous essayons au contraire de proposer davantage. Un peu de kitsch et d’humour font du bien de temps en temps – il ne faut pas toujours être trop sérieux. Les belles compositions intérieures ne nécessitent pas l’emploi de teck ou de pierres coûteuses, et des matériaux bon marché font bien souvent l’affaire. Axel appelle cela «l’équilibre de l’horreur». À Rigiplatz, où nous habitons nous-mêmes dans l’un des deux bâtiments de la coopérative (2010), nous devions veiller à ce que les coûts restent bas et avons utilisé une pierre à motifs couleur fromage d’Italie. Elle est bon marché et arrive par bateaux – où elle sert de lest – du Brésil ou des pays de l’hémisphère sud. On trouve aussi de la résine synthétique qui imite le bois – du cerisier américain en l’occurrence –, des sols en grès cérame fin, relativement banal mais inhabituellement posé, et quelques miroirs. Pour les jeunes membres de la commission de construction, c’était presque un sacrilège et nous avons d’abord dû les convaincre. Mais cela a donné un résultat superbe. On a l’impression que les bâtiments ont toujours été là.
AF Les coopératives immobilières, en particulier, sont soumises à une forte pression sur les coûts. Utiliser les matériaux de manière subversive, c’est la seule façon de créer des combinaisons inhabituelles et qui étonnent.
Parlons maintenant des plans et surtout des coupes de vos logements. Vous proposez – et réalisez – souvent des pièces à un étage et demi ou à deux étages.
AF La différenciation en hauteur fascine chaque architecte. On le sait de Le Corbusier et de son Immeuble Villa, une référence particulièrement représentative parmi toutes celles qui offrent des vides de deux étages. Les études nous ont aussi permis de découvrir Moissei Ginsburg, une icône parmi d’autres. L’immeuble Narkomfin (1930) à Moscou avait déjà servi de modèle à l’Unité d’habitation corbuséenne, même si les pièces n’y font «que» un étage et demi. Cela sous-entend inévitablement un travail de volumétrie avec des unités décalées, c’est-à-dire une sorte de juxtaposition décalée des étages. Cela donne des hauteurs sous plafond de 3,8 à 4 mètres, très intéressantes pour créer une atmosphère spacieuse malgré un habitat dense. Nous avons essayé à plusieurs reprises d’appliquer cela dans la construction de logements. Les chances de remporter des concours avec ce concept sont bien sûr très limitées, car les pièces hautes sont difficilement conciliables avec nos exigences en matière de rentabilité dans la construction de logements. C’est le revers de la médaille.
Vos appartements témoignent aussi d’un goût ludique pour la juxtaposition de la petite et de la grande échelle.
AF Absolument, et nous nous assurons de renforcer cela de différentes manières. Le séjour d’un étage et demi de la maison sur la Wiesenstrasse à Winterthur (2005) est par exemple équipé d’une cheminée qui n’est pas qu’un simple trou dans le mur, mais un corps plastique placé dans un angle, qui s’étend sur toute la hauteur et la met en valeur. C’est quelque chose de monumental. L’inspiration nous est venue d’un palais vénitien, et tout à coup, les pièces ont acquis une sorte de noblesse. Je cite cet exemple parce que, tant dans la ville que dans l’appartement, il faut toujours quelque chose qui nous sorte un peu du quotidien. Un peu d’extraordinaire ou de luxe, ou peut-être plutôt une atmosphère dominicale.
Nous voulions aussi créer des logements de ce genre pour des coopératives, mais il est difficile de jouer avec les hauteurs de niveaux et les étages en saillie, en raison des directives en matière d’accessibilité. Il faut miser sur d’autres aspects, concevoir les appartements de plain-pied et réfléchir à ce que l’on peut leur apporter afin qu’ils expriment plus qu’un simple schéma fonctionnel.
Alberti affirmait que «la ville est une maison et la maison est une ville». Et cela peut s’appliquer directement. De notre point de vue, un appartement a besoin d’une structure hiérarchique, à l’image d’une ville avec ses espaces publics et privés, ses éléments imposants, d’autres plus normaux, ses places et ses rues. C’est quelque chose qu’on peut donner à un appartement coopératif: un ordre hiérarchique clair et une présence urbaine marquée.

Immeubles résidentiels Rigiplatz, Zurich, 2010 | Photo: Walter Mair
L’architecture est actuellement pointée du doigt pour sa responsabilité dans les émissions de CO2 – extraction des matières premières, production des éléments constructifs, construction, entretien, démolition et élimination. Cela a-t-il changé votre façon d’utiliser les matériaux?
AF Nous parlons sans cesse de durabilité. On ne peut pas se permettre de l’ignorer. Nous sommes cependant convaincus que cela ne doit pas se réduire à un simple exercice de calcul. Je ne pense pas qu’il soit judicieux de tout remettre en question, et je ne pense pas non plus que l’urgence de la situation va engendrer quelque chose de fondamentalement différent. Certains collègues disaient déjà dans les années 1960 que «l’architecture va connaître une révolution». Ils pensaient peut-être à des façades technoïdes et intelligentes. Aujourd’hui, on entend que «le débat sur le climat nous force à voir les choses différemment, que l’architecture renaît.» Pourtant, la construction n’a pas beaucoup changé et ne changera probablement pas maintenant non plus. Nous pensons que la permanence doit occuper une place plus importante dans le débat. Tous ces calculs sont, d’une certaine manière, absurdes. Nous préférons en fin de compte ce qui nous est familier, la tradition et ce qui a fait ses preuves depuis des milliers d’années.
Pourquoi savons-nous à quoi ressemblait le temple étrusque, qui pourtant était construit en bois? Il était entièrement recouvert de plaques de terre cuite pour le protéger. Chaque poutre et le fronton étaient recouverts de plaques d’argile cuite ou de briques. Le bois a disparu au fil des siècles ou des millénaires, mais les plaques de terre cuite ont persisté. Ce n’est donc pas la structure, mais l’enveloppe qui nous permet de savoir à quoi ressemblait le temple. Ce que je veux dire par là, c’est que nous ne devrions pas concevoir des bâtiments pour 50 ans, mais pour l’éternité, si possible.
La chaux et la brique sont des matériaux utilisés depuis 5000 ans et qui ont une longue durée de vie. Pourquoi parler de durabilité? On peut discuter du béton, car sa production est vraiment coûteuse. Mais le peu de feu nécessaire pour la chaux et la brique... et le bois, c’est plutôt bien, non? Mais nous ne pouvons pas construire tous les bâtiments en bois, sans quoi nos forêts finiront par s’épuiser. Et où sont passées nos scieries qui transforment le bois? Devons-nous l’importer du Bregenzerwald, ou de Pologne et de République tchèque, où il y a encore aujourd’hui des scieries, et qui plus avec des 40 tonnes?
KK Quoi de plus durable, finalement, sinon que les gens aiment un bâtiment? Que les appartements soient appréciés? Qu’ils soient abordables et accessibles financièrement? C’est important de pouvoir s’identifier à l’endroit où l’on vit, et qu’un bâtiment ne soit pas quelconque et qu’il soit inconcevable de le trouver ailleurs. Que l’on puisse se dire, j’habite en ville, dans ce quartier, dans cette maison où je connais celles et ceux qui y vivent, et tou·te·s s’y identifient également.
Nous ne considérons pas le Lifetime Achievement Award comme le point d’orgue de votre œuvre, mais plutôt comme l’occasion de découvrir ce qui vous occupera pour les mois et les années à venir.
KK Nous travaillons actuellement sur des maisons multigénérationnelles offrant de nombreux appartements en cluster, adaptés à différents modes d’habiter. À Hornbach, deux appartements en cluster répartis sur trois étages existent déjà. Ils ressemblent à de petits palais vénitiens, avec de grandes pièces communes.
Y a-t-il des contextes qui vous intéressent particulièrement?
KK Nous venons de perdre un concours pour un ensemble en limite de périphérie urbaine, à la jonction avec la campagne. Ce type de contexte nous intéresse. Les villages et les communes situés aux abords des grandes villes sont menacés par l’étalement urbain et ont besoin de solutions. C’est là que se construit l’agglomération en général. La ville s’étend dans la campagne en créant de nouveaux quartiers à grande échelle. Et dans les villages, on construit des immeubles gigantesques qui ressemblent à des corps isolés et disproportionnés. La solution n’est pas de construire les mêmes types d’appartements et à la même échelle qu’en ville. Les bâtiments doivent être en rapport avec le paysage. Il faut créer des formes de transition spécifiques entre l’espace urbain et le paysage. Nous aimerions y faire passer un message.

Maison individuelle à Uesslingen Uesslingen, Zurich, 2024 | Photo: Peter Knupp
Quelle alternative proposez-vous?
KK Nous avons remporté plusieurs projets qui attendent le feu vert et traitent de ce contexte «rural» – paysager. Urbain ou rural, peu importe le contexte, notre préoccupation centrale reste la création de quartiers et de lieux particuliers. Comment habite-t-on à la campagne sans maison individuelle, par exemple?
AF Les tâches complexes nous intéressent également. Nous travaillons depuis longtemps déjà avec Miroslav Šik sur l’ensemble Frohburg à Zurich-Schwammendingen, un projet à travers lequel nous testons la capacité de transformation de la cité-jardin. Qu’arrivera-t-il si elle prend soudainement une autre dimension avec des bâtiments de sept ou huit étages? L’espace extérieur sera forcément modifié, mais comment? La considèrera-t-on alors encore comme une cité-jardin, ou deviendra-t-elle une agglomération de plus? Nous trouverions dommage qu’elle perde son caractère verdoyant ou qu’elle cède la place à un ensemble immobilier quelconque.
Comment bien réagir au lieu? La question nous préoccupe également dans le cadre d’un autre projet à Saint-Gall, sur lequel nous travaillons actuellement à la suite d’un concours remporté pour un bloc urbain situé à la périphérie de la ville. Nous avons beaucoup construit à Zurich, mais nous abordons ce projet différemment, car Saint-Gall a un caractère légèrement différent, même si cela est à peine perceptible. La ville a quelque chose de plus montagneux, de plus oriental, des particularités que nous voulons capturer et rendre perceptibles dans l’architecture.
Avec le recul, feriez-vous certaines choses différemment?
AF Notre œuvre nous a accompagné de manière divertissante, et nous en sommes très satisfaits. Nous nous y reconnaissons et elle continue de nous parler.
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous pour l’avenir, en termes d’architecture?
KK Encore et toujours une pincée d’humour, sans oublier un peu de gloire et de renommée.
Le texte a été publié dans le Swiss Arc Mag 2025–6 et traduit en français par François Esquivié. Commandez votre exemplaire ici.
Vous pouvez télécharger laudatio de Remo Derungs au format PDF.