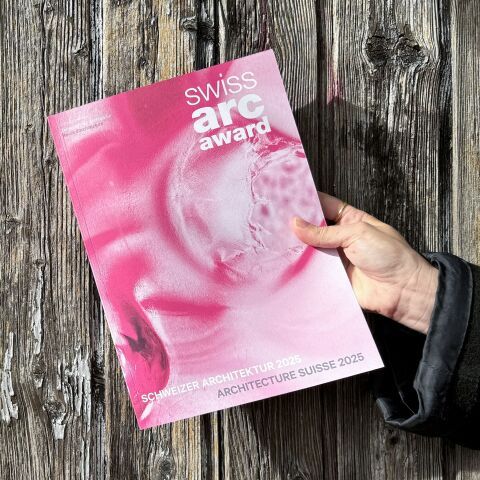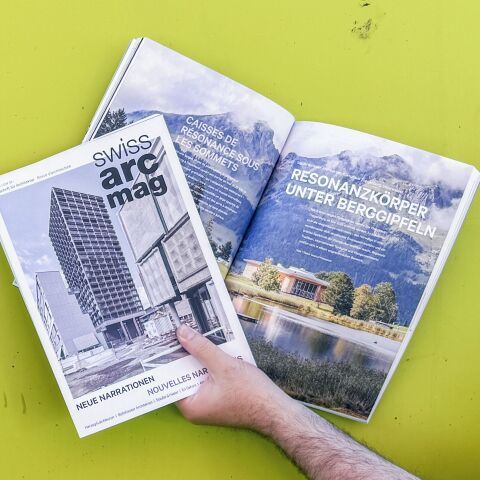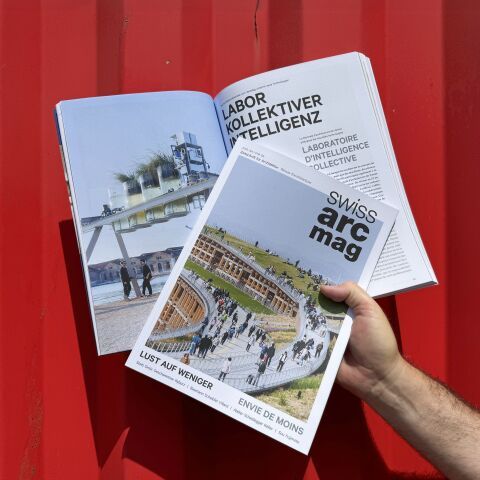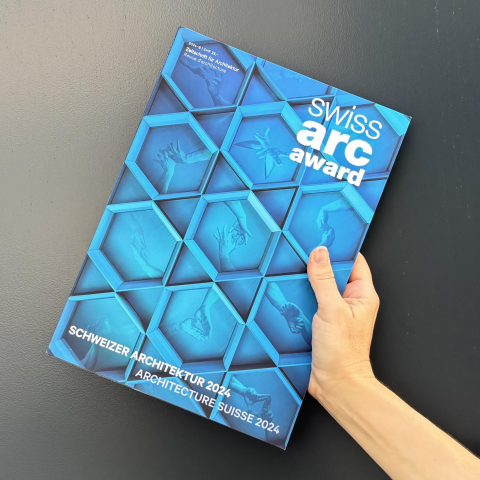L'Arc Mag 2024–2 fait le point sur les zones calmes
Lorsqu’en 2005 le Studio Basel a présenté son étude «La Suisse – portrait urbain», les régions qu’ils appelaient «zones calmes» – le Gros-de-Vaud, les Préalpes fribourgeoises, la région du Napf et Appenzell-Toggenburg – ont fait sensation. Les développer le moins possible et les conserver plutôt comme parcs naturels était suggéré.
Qu’est-il advenu de ce discours près de deux décennies plus tard? Depuis, la Suisse a gagné 1,2 million d’habitant·e·s. Puisque les terrains non construits se raréfient dans les espaces métropolitains et que la densification intra-urbaine ne peut pas suivre le rythme de la croissance des besoins en espace intérieur, l’urbanisation a continué à s’étendre dans les zones calmes, conformément aux pronostics. Cela a passablement modifié les sites et les paysages. La biodiversité a été particulièrement touchée; elle a subi une pression massive. Avec le recul, on se rend compte qu’une délimitation aussi large que possible n’aurait pas seulement été bénéfique pour les villages et les paysages, mais aussi et surtout pour la préservation de la faune et de la flore.
Dans le présent magazine, la rédaction zoome sur plusieurs constructions en zones calmes en présentant quatre nouveaux projets situés dans ou à proximité des régions définies par Studio Basel. Lors de leurs visites sur places, les auteur·rice·s des articles ont constaté que les zones calmes sont devenues plus bruyantes, les constructions s’y multiplient et les infrastructures s’y développent continuellement. L’appel de Studio Basel à les entretenir dans leurs spécificités et à cultiver leur «lenteur» aurait-t-il donc été vain? Politiquement, il faut sans doute en faire largement le constat. Mais dans l’esprit des architectes – du moins de certains protagonistes – l’idée de valoriser la leuteur et la retenue a persisté. Ils tentent de conserver ou de développer l’image architecturale des petites villes, des villages et des hameaux par des constructions et des transformations discrètes. Cela peut paraître romantique ou quelque peu nostalgique. Les quatre projets de notre revue montrent cependant qu’il est possible de développer de nouvelles constructions à partir du contexte et de les ancrer dans leur site, tout en créant des configurations spatiales intérieures contemporaines – parfois même urbaines – qui lient les mondes ruraux des zones tranquilles et les exigences urbaines qui s’y imposent, de plus en plus vigoureusement.
La rédaction vous souhaite une bonne lecture!