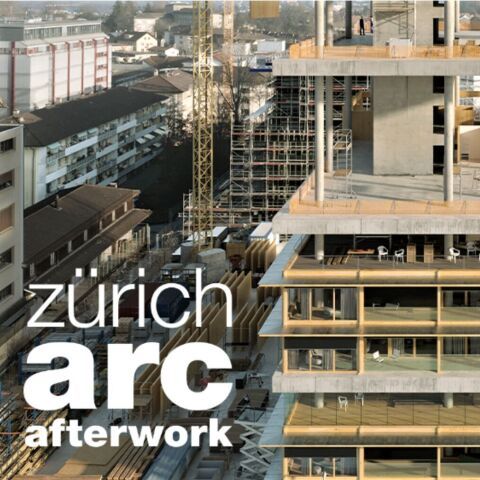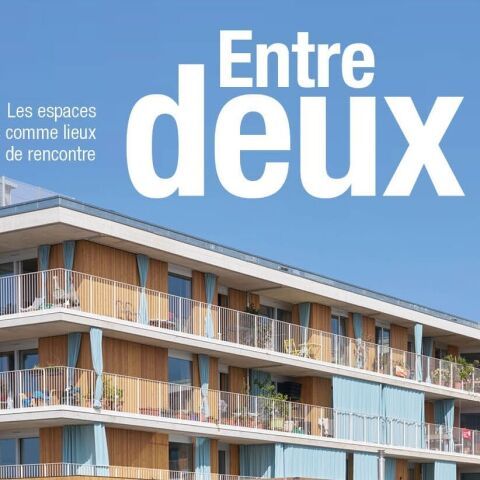Espaces communs, dynamiques du vivre-ensemble – retour sur l’Arc Afterwork de Lausanne
Une coursive, une terrasse, un patio ou une rue… Ces gestes architecturaux, en apparence anodins, peuvent révéler tout le potentiel d’un bâtiment, notamment lorsqu’il s’agit d’offrir un cadre de vie digne à des populations socialement défavorisées. Le 27 août 2025, lors de l’Afterwork organisé par Swiss Arc au Musée Olympique de Lausanne, cette question – celle de la valeur et du rôle de l’aménagement des espaces publics partagés – était au centre des discussions.

Théo Bellmann, Vincent Mas Dubrec, Arnaud Michelet, Nicolas de Courten, Katrien Vertenten, Zoé Géhin, Rafael Eloi, Guillaume Schobinger et Lya Blanc lors de la discussion avec le public (de gauche à droite) | Photo: Pedro Gutierrez Fernández
Les espaces publics partagés doivent occuper une place plus importante dans la réflexion des architectes, en particulier lorsque les projets abordent la question du vivre-ensemble au sein de réalisations immobilières d’envergure. Cette thématique était au cœur d’une rencontre organisée à Lausanne, réunissant une centaine de professionnels de l’architecture et de la construction autour de neuf projets emblématiques. Le format de la soirée, à la fois compact et varié, a donné lieu à des présentations dynamiques animées par Lya Blanc (Tribu architecture), Zoé Géhin (apaar), Arnaud Michelet (En-Dehors), Katrien Vertenten (Nomos Architectes), Théo Bellmann (Labac), Vincent Mas Dubrec (dl-a), Rafael Eloi (meier + associés), Guillaume Schobinger (Itten + Brechbühl) et Nicolas de Courten (Nicolas de Courten Architectes).
La concertation est une vertu
«Les architectes ont-ils tendance à trop dessiner?» a entendu le public présent en guise de provocation. «Le maître d’ouvrage est-il assez flexible?» «Le projet initial peut-il laisser une marge de fantaisie?» Toutes ces questions évoquent la nécessité d’une concertation entre les différents acteurs d’un projet immobilier à forte vocation sociale. Tous les architectes invités sur la scène ont souligné la valeur d’un dialogue permanent avec le maître d’ouvrage. Des relations essentielles, surtout lorsqu’une collectivité publique est impliquée.
Ce qui est parfois considéré comme élément architectural mineur a ainsi pris du sens. Les balcons ou les coursives peuvent être exploités comme lieux d’interaction sociale, comme dans le cas de la construction de la coopérative du Bled, dans l’écoquartier des Plaines-du-Loup, à Lausanne. Un système de rideaux permet à chaque appartement donnant sur les coursives communes de préserver son intimité. Mais l’espace reste résolument partagé, propice à diverses activités ludiques et aux échanges.
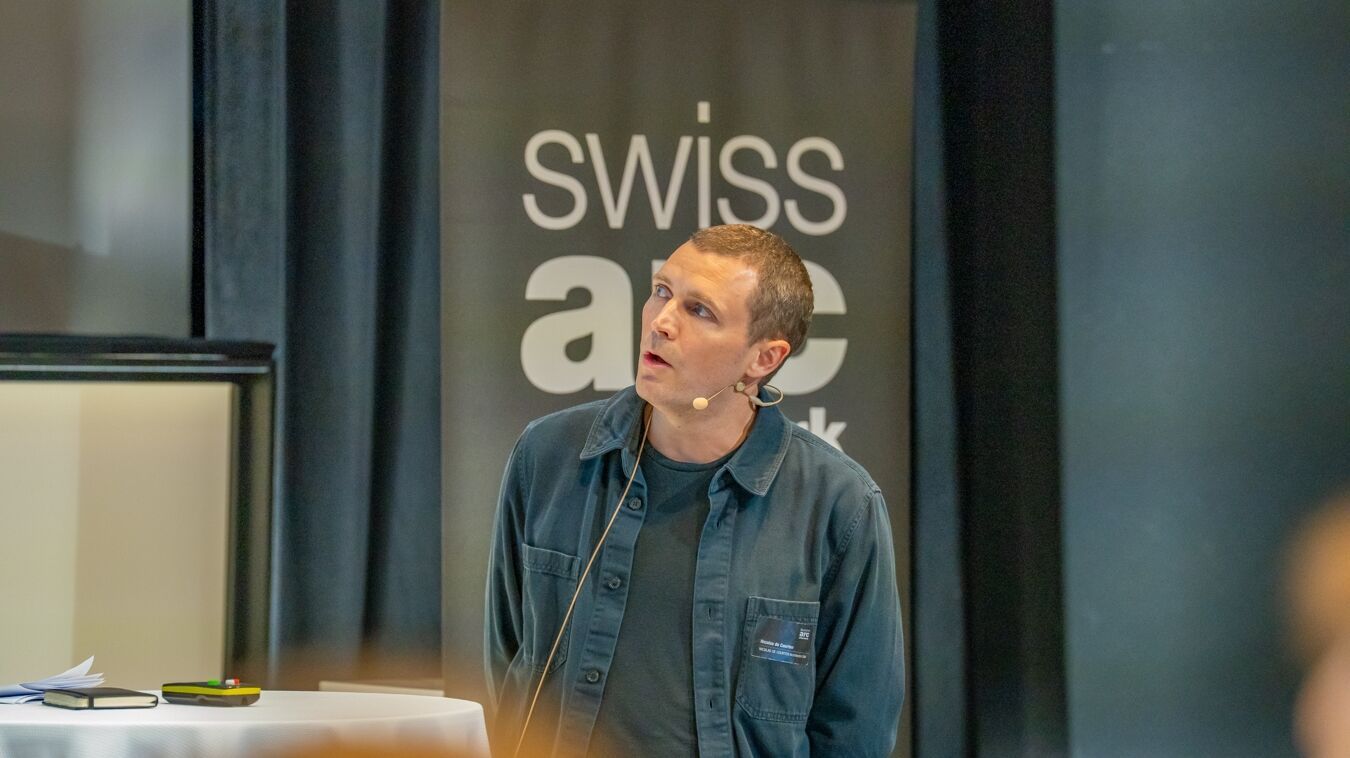
Nicolas de Courten | Photo: Pedro Gutierrez Fernández
Une dalle reconvertie verticalement
Cette exploitation d’un espace a priori négligeable dans un processus de construction touche aussi les voies de circulation au sol. À cet égard, la réhabilitation d’une rue bordant le parc genevois des Minoteries a su exploiter les éléments de la dalle existante sur le site à des fins d’aménagement de structures ludiques ou sociales. Mieux encore, en Valais, l’ancienne station d’épuration d’Aproz, désaffectée depuis plus de trente ans, a été totalement reconvertie en place de jeux pour enfants, pour s’adapter à un bâti qui a évolué au fil du temps. Ce type de reconversion illustre l’ingéniosité des architectes suisses, capables de transformer des espaces résiduels en véritables catalyseurs de sociabilité. Ces espaces publics communs jouent un rôle important dans l’animation d’un programme de construction. Cela est notamment essentiel dans la rénovation de bâtiments publics, à l’instar de l’école des Pâquis, à Genève. Ce bâtiment, qualifié par les architectes de «vieille peau» à préserver, a subi une cure de jouvence sans pour autant perdre ses atouts architecturaux d’origine. Justement en agissant sur les espaces communs. La réflexion entamée sur les bâtiments scolaires s’est ensuite étendue au préau, aire à l’origine fermée puis ouverte sur son quartier. Cela a revitalisé la vie sociale au cœur de Genève.La nature a horreur du vide. Mais ce dernier peut aussi faire sens, comme pour la pièce urbaine C des Plaines-du-Loup. Les logements construits en ce lieu s’animent aussi par les interstices situés à côté des constructions. Une touche de couleur ou un aménagement paysager suffisent à animer l’espace.
Affirmer la dimension sociale
Tous les intervenants se sont accordés pour affirmer que l’architecture peut dynamiser de cette manière sa forte dimension sociale. À condition de s’affranchir de ses stéréotypes et qu’elle joue sur l’appropriation d’un endroit par ses résidents. L’architecte ne doit pas chercher à imposer ses hypothèses. Il doit aussi convaincre le maître d’ouvrage afin de déployer tout son potentiel, de la conception à la réalisation.
Première publication dans Swiss Arc Award Mag 2026–1. Commandez votre exemplaire ici