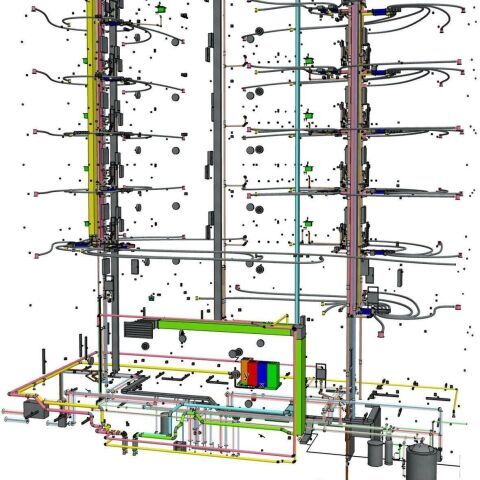La Beauté des choses – interview avec Daniel Zamarbide
Certains projets de BUREAU peuvent sembler au premier regard épurés et cadrés. Et puis, il y en a d’autres comme La Casa do Monte qui semblent plus additifs en termes de matériaux, de couleurs et de formes. Ces références au thème de l’Arc Mag ont servi d’accroche pour développer cette discussion avec Daniel Zamarbide au sujet de sa méthode de travail et de l’avenir de l’architecture face aux crises actuelles.
Quand est-il judicieux de concevoir un concept pur, de se concentrer sur une idée, et à l’inverse, quand faut-il rechercher la complexité, combiner différentes idées et faire des collages?
Je n’ai jamais pensé que l’architecture avait quoi que ce soit de pur. Je n’aime pas vraiment ce mot, en revanche le mot addition est très intéressant, nous faisons que d’additionner. En tant qu’architecte, on va toujours créer ou participer à quelque chose, et donc l’additionner à un environnement existant, même si ce que l’on ajoute peut être très peu.
Je crois beaucoup plus à la complexité qu’à la pureté. Il y a quelque chose qui me dérange profondément dans l’idée d’aller vers une forme de pureté de toutes sortes. Comme si l’on devait toujours faire des églises. C’est aussi nier la réalité du monde, qui est impur par essence, qui se nourrit d’une multitude de sollicitations et de contextes. Donc personnellement, je pense que l’impureté semble plus opérationnelle et plus réelle. Le fait de s’impliquer personnellement dans les projets amène déjà des formes de complexité et d’impureté.
Pourquoi les nouvelles constructions sobres, épurées et poétiques sont-elles pourtant aujourd’hui principalement considérées comme de la «bonne» architecture?
Je ne suis pas sûr que ce que tu appelles la «bonne» architecture se trouve uniquement à l’intérieur de ces trois mots. Je ne suis même pas certain non plus que le fait de distinguer de manière dialectique le «bon» du «mauvais» soit très opérationnel pour répondre à notre contemporanéité. Chaque contexte, chaque occasion, chaque situation possède des potentiels latents, des «devenirs» possibles, comme dirait Gilles Deleuze. Et ceux-ci conditionnent les possibilités d’intervention architecturale et spatiale. Le «bon» et le «mauvais» sont des constructions culturelles qui varient avec les saisons, avec les mouvements de nos sociétés.
L’idée d’addition est quelque chose qui revient souvent dans tes projets. On peut le voir avec Mr. Barrett’s ou avec la Dodged House par exemple.
Les deux exemples cités sont deux transformations assez diverses et effectuées dans des contextes très différents. Dans le cas de Mr. Barrett’s House, nous avons été sollicité par un client pour faire un travail sur le jardin d’une grande villa. Dans le jardin ce trouvait une maisonnette servant de garage au rez-de-chaussée et habitée par le gardien à l’étage. Au fil des travaux dans le jardin, nous avons réfléchi avec le client et proposé de transformer cette maisonnette. Nous avons donc déplacé la partie supérieure de la maison afin que l’on puisse détruire la partie du garage. Et après avoir reconstruit le rez-de-chaussée, nous avons replacé la partie supérieure sur le nouveau socle. Il s’agit donc d’un exercice cinématographique de montage à partir des éléments en lieu et en place. Formellement, nous n’avons pas été très créatifs. Peut-être au rez-de-chaussée, où l’on a travaillé avec des fenêtres rondes qui ne correspondaient pas, à priori, au langage originel, et là il y a un effet de collage sur la façade.
Qu’en est-il de la Dodged House?
La Dodged House au Portugal était à la base une ruine dont nous avons repris la façade. Et la surélévation, si l’on peut l’appeler ainsi, peut être vue comme une addition. Mais la réalité était qu’il fallait respecter toute la rythmique de la rue, des embrasures, toute la mode et nature qui fait que la maison est presque dissimulée. À Lisbonne, beaucoup de maisons sont abandonnées, les propriétaires ne veulent pas qu’elles soient squattées, ils ferment donc les façades et cela crée de très beaux murs borgnes. Nous avons donc repris la façade existante sans fenêtres. Là où il y a plus une forme d’addition, c’est entre l’intérieur et les façades, entre contenant et contenu, là où se trouve une forme de collage moderniste.
C'était un peu comme une psychothérapie personnelle face au modernisme que j'ai refusé pendant très longtemps et avec lequel j'étais aussi en tension depuis mes études. Et en traversant les années, je commence à y trouver des intérêts, à lire les différentes «textures» et approches de ce mouvement complexe et énorme. Il y a un collage qui rend tout en tension. L'idée est d'utiliser la carcasse existante, de vider l'intérieur et de recréer de la spatialité.
MÉTHODES
Comment choisis-tu les formes que tu associes dans tes projets?
Même si en tant qu’enseignant à L’EPFL et à la HEAD de Genève, je parle très peu de cela dans les premières années d’études, je n’ai pas de problème à travailler avec des questions esthétiques et formelles. C’est comme la musique que l’on écoute, on a des goûts! Et on ne peut pas les nier. On ne peut pas se déclarer architecte neutre, comme si on pouvait s’effacer, ou comme si on s’habillait n’importe comment. Je pense donc que la question esthétique est importante. Je pense être assez proche du minimaliste et de l’art conceptuel américain qui naît des années 1960 – 1970. J’aime beaucoup la complexité mais à partir d’un langage formel assez réduit.
Il me semble pourtant qu’il s’agit parfois plus que d’une question d’esthétique. Ces formes sont-elles le résultat de recherches et de concepts?
Oui bien sûr. Dans mon cas, je travaille beaucoup par dialogues avec d’autres projets, avec l’histoire de l’architecture ou l’histoire de l’art. Il y a donc toujours une sorte de monde référentiel qui habille le projet et qui dialogue avec. Cela m’aide aussi beaucoup à gérer les questions esthétiques. Et puis, à un moment donné, tout cela prend une forme de synthèse assez précise dans le projet.
Tu parles tantôt en «je», et tantôt en «nous». Comment est organisé BUREAU, est-ce un travail d'équipe?
Nous sommes trois partenaires, Carine Pimenta, Galliane Zamarbide et moi-même. Notre collaboration est très informelle, dû à la petite dimension du bureau, et assez intimiste. Les projets, idées, développements, et l’administration se font principalement à travers des discussions relativement peu organisées ou spontanées. Et en même temps, nous croyons énormément en l’efficacité de décision et d’action. Notre travail s’effectue entre Lisbonne et Genève, et je suis en effet le principal porte-parole. Mais le travail se fait partout et tout le temps. L’inconvénient de cet «intimité» entre nous trois réside dans le fait que la vie privée et professionnelle se mélangent souvent.
Quelle est ton approche des matériaux lors de la conception? Essayes-tu de limiter le nombre de matériaux au profit d’un aspect général fort ou mises-tu sur la combinaison de différents matériaux, couleurs et surfaces?
Je n’ai pas de matériaux de prédilection. Il n’y a ni de limites, ni de palettes. Nous essayons en revanche de tirer profit des matériaux relativement bruts. C’est plus en termes d’atmosphère générale que les choses se travaillent. Il faut parfois avoir un tout petit peu de retenue, comme à la Dodged House par exemple. La vie occupe ensuite l’espace, et c’est aussi cela qui donne de la matérialité ainsi que de la couleur dans un projet.
On dit également souvent qu'un bâtiment est complètement terminé seulement quand il est habité et utilisé.
Je pense aussi qu’un bâtiment n’est jamais terminé, c’est aussi le problème que l’on a en tant qu’architecte, notre travail s’arrête à un moment donné, très souvent au même moment où l’habitat commence. Nous devrions apprendre à habiter autant qu’à designer.
Cela signifie que tu essayes de laisser le plus de liberté d’appropriation possible? En fin de compte, tu ne sais pas toujours qui va emménager et quelles sont les attentes des futurs habitants.
J’ai déjà dit de manière un peu provocante que je ne design jamais un endroit où je ne peux pourrais pas me projeter moi-même en tant qu’habitant. Ça peut sonner très égocentrique, en disant que j’impose à tout le monde ma manière de faire, mais moi je le vois à l’inverse, je le vois comme une forme d’honnêteté, ce sont des typologies et des atmosphères dans lesquels je peux me projeter.
La couleur est également un élément qui revient souvent dans tes projets, comme par exemple dans la Casa do Monte. Peux-tu nous expliquer d'où vient le choix de la couleur bleue que tu as utilisée pour tous les éléments de serrurerie?
Ce sont des choix évidemment relativement subjectifs. Nous avons trois à quatre couleurs que l'on utilise de manière systématique mais qui évolueront avec le temps. La ville de Lisbonne est très colorée, elle possède plein de couleurs très pastelles qui la dominent, et nous nous sommes rendu compte que vivre au milieu de ces couleurs était très agréable. À Casa do Monte, l'idée est de ponctuer quelques interventions avec une couleur qui signale certains objets. Il y a aussi toute cette logique moderniste, de machine à habiter qui rentre en compte avec la signalisation, par la couleur, des éléments constitutifs.
J’ai l’impression qu’aujourd’hui plus que jamais, l’architecture standard doit avant tout être économique et fonctionnelle. Le reste importe parfois peu. Dans ton travail, il est évident que tu en veux plus. Que recherches-tu exactement?
Nous essayons de ne travailler que sur des projets qui nous intéressent vraiment. Ces conditions-là nous amènent à être dans des formats d'architecture très différents. Pour moi, designer une lampe, faire une scénographie, une muséographie, travailler avec une pièce de théâtre, ou construire une maison, c'est la même chose. Ce qui nous importe beaucoup, c'est de fabriquer. Et dans tous ces petits objets, l'envie de construire est bien présente.
Les processus des architectes qui construisent énormément sont très longs, ils passent par beaucoup de contraintes, et effectivement dans ces contraintes là, il y a beaucoup de rationnel et de pragmatisme. L’architecture fait partie du monde de la construction, qui est l’un des moteurs de notre société, donc très lié à l’économie et à la politique. C’est donc aussi l’un des milieux les plus pourris. Qu’on le veuille ou non, si l’on se confronte à faire de l’architecture, on est également un tout petit peu là dedans. Moi, petit à petit j’ai essayé de me détacher un peu de ce monde. Je ne travaille pas du tout dans une logique économique, ni dans une logique de rendement financier, et c’est cela qui m’amène à travailler dans des contextes très divers qui offrent des possibilités de créativité.
VAINCRE LA RIGIDITÉ
Cela semble génial de pouvoir choisir tes domaines d’activité. Mais en tant qu’architecte, n’a-t-on pas aussi une responsabilité sociale? Ne doit-on pas accepter de temps en temps des tâches qui ne sont pas très agréables?
Il ne s’agit pas de faire ou ne pas faire des tâches agréables. Notre travail n’est de loin pas facile et passe par énormément de sacrifices et difficultés diverses. Nous ne passons pas nos journées à dessiner des aquarelles et regarder des livres, tu peux bien l’imaginer. Mais je trouve que les contraintes actuelles sont très frustrantes parce qu’elles ne font pas face à l’évolution du monde contemporain. Par exemple à Genève dans les années 1960, même les architectes les plus rationnels comme les frères Honegger amenaient quand même des idées de spatialité très fortes, les rez-de-chaussée étaient libres, il y avait plus d’espace! Aujourd’hui, on ne retrouve plus cela. Ce changement vient notamment du contexte économique, mais également du décalage flagrant entre ce qui se construit et les évolutions sociétales.
Le logement reste un élément qui m'intéresse beaucoup. Par exemple pour la Dodged House, on a travaillé sur des minuscules espaces, la maison fait 94 m2 sur quatre étages. Et ce travail typologique, on peut le faire seulement dans un logement privé. Dans le logement standard, c'est impossible car les normes sont très strictes. Ce qui me dérange également, c'est que l'on construit encore aujourd'hui pour des familles standardisées et hétéronormées, composées d'une mère, d'un père, et de deux enfants. Or, le monde a beaucoup changé, et cette typologie ne change pas. Un espace doit aussi permettre l'appropriation.
Selon toi, quel est l’avenir de l’architecture, en particulier face à la crise climatique?
Je pense qu'à l'avenir nous construirons beaucoup moins de nouveaux bâtiments. Nous devrions essayer de travailler davantage avec l'existant et de comprendre l'architecture comme une tâche qui consiste à apporter de petits compléments, parfois éphémères. La plupart des villes sont construites, et j'aime les regarder comme si elles étaient arrêtées. Je les observe avec curiosité, sans porter de jugement sur ce qui existe déjà. Les architectes ont l'ambition de vouloir améliorer le monde. Il doit néanmoins y avoir une discussion plus approfondie sur la question de savoir si quelque chose que l'on prévoit d'ajouter ou de supprimer génère de nouvelles qualités.
Je trouve important qu’il reste toujours de la place pour l’appropriation. Dans la mesure où peu de nos projets étaient des constructions nouvelles, nous sommes déjà dans cette voie.
Interview de Daniel Zamarbide par Valentin Oppliger